Chapitre 6
Grandeur et
décadence de l’artisanat
À tout seigneur, tout honneur : nous commencerons
ce chapitre sur l’artisanat à Fougerolles et dans sa région par l’évocation de
l’industrie la plus renommée du coin, la distillerie. La distillation des fruits
y remonte certes à plusieurs siècles – sans doute au 17ème – pour ce
qui concerne les bouilleurs de cru, mais il faut attendre l’instauration de la
« Régie des Droits Réunis » sous le Premier Empire pour voir cette
activité passer au stade artisanal, avant d’accéder plus tard au niveau
industriel. Le meilleur exemple en est la famille Lemercier, du Grand Fahys, qui obtint une licence de distillateur sous
Napoléon, transféra ses ateliers à Fougerolles-l’Église
en 1881, à proximité de la gare nouvellement construite, installa
une distillerie moderne, créa une tonnellerie très active, une vinaigrerie et
un commerce de vin à côté de la maison Leyval. La
maison « Lemercier frères » devint ainsi une vaste entreprise
diversifiée qui, avec les maisons Bresson et Peureux, contribua à faire de
Fougerolles la capitale du kirsch et le centre de production de divers produits
comme l’absinthe et les liqueurs. En dehors de ces grands établissements de
réputation internationale existaient de nombreuses distilleries familiales plus
modestes, qui contribuaient activement à la renommée du pays.
L’art ancestral de la distillation n’était évidemment
pas la seule et unique occupation des Fougerollais et
de leurs proches voisins. Dans une contrée aussi riche en cours d’eau et en
forêts s’était développée dans les vallées de la Combeauté,
de l’Augronne et de la Semouse
une petite industrie sidérurgique à laquelle la Seconde Guerre mondiale fut
fatale. On y voyait encore dans les années 1930 de modestes usines qui
fabriquaient des clous, du fil de fer, des tôles, des plats et des casseroles
et dont il ne reste plus rien que quelques ruines. Ces vieilles industries
n’ont pas su s’adapter au système moderne de production, contrairement au
textile arrivé d’Alsace après 1871 sur le versant ouest des Vosges, mais déjà
implanté au Val d’Ajol et à Fougerolles dès le milieu
du 19ème siècle avec les filatures de la famille Murbach,
originaire du Pays de Bade. Fougerolles-le-Château devint ainsi une sorte de
banlieue industrielle. Le tissage Fleurot, installé à
Fougerolles et au Val d’Ajol, aura une existence
beaucoup plus éphémère que l’entreprise Murbach, plus
tard Antoine et Jacamon. L’usine Fleurot
fut en effet reprise pendant l’Occupation par les « Constructions
Mécaniques Lorraines », l’actuelle usine « Comelor »
récemment acquise par un groupe américain.
Qui aurait pu imaginer dans les siècles passés que
Fougerolles connaîtrait un jour de pareilles transformations à l’échelle de la
mondialisation ? Certainement pas les humbles représentants des vieux
métiers du bois tels que menuisiers, charrons ou sabotiers. Il y eut jusque
dans les années 1930 deux saboteries mécaniques dans la localité, mais de
nombreux paysans fabriquaient leurs propres sabots pendant la période
hivernale, avec du bois de hêtre ou de bouleau et à l’aide d’outils comme
l’herminette, le paroir 
 et la langue
de chat. Le sabotier fougerollais fumait
ses sabots sur un brasier de copeaux en y ajoutant du poil de cochon qui leur
donnait une belle teinte rousse.
et la langue
de chat. Le sabotier fougerollais fumait
ses sabots sur un brasier de copeaux en y ajoutant du poil de cochon qui leur
donnait une belle teinte rousse.
Le charronnage était un travail beaucoup plus délicat,
qui ne s’improvisait pas. La fabrication des roues exigeait de l’expérience et
du savoir-faire, notamment pour l’élaboration du moyeu, tourné dans du chêne,
de l’acacia ou de l’orme. Une foule d’opérations successives étaient
nécessaires pour obtenir une roue assez solide pour supporter des charges très
lourdes, comme le poids des troncs d’arbres lors du débardage des bois.
La fabrication des jougs de bœufs et des pieds-de-chèvre
était infiniment plus simple et pouvait être le fait des agriculteurs
eux-mêmes, artisans improvisés mais souvent fort adroits. Le pied-de-chèvre,
outil jadis indispensable et toujours utilisé aujourd’hui pour la cueillette
des fruits à cause de sa stabilité, se compose d’un pied taillé à l’herminette
dans un bois dur et lourd (chêne, poirier ou pommier), et d’un tronc de sapin pouvant atteindre plus de dix
mètres de haut. Ce fût de sapin, une fois écorcé et séché, était percé à la
tarière de trous dans lesquels on fixait les dents, barreaux d’acacia
fendu qui évitaient aux sabots des cueilleurs de glisser.
La menuiserie était autrefois une activité florissante
à Fougerolles comme ailleurs. Tous les meubles de la famille sortaient des
ateliers du coin, en particulier les buffets, les armoires et les lits de
campagne en cerisier et en chêne qui constituaient le mobilier de ma maison
natale. Les meubles de la chambre de la tante Gabrielle, plus élaborés que les
autres, étaient l’œuvre d’un menuisier nommé Picot, qui avait des dettes envers
mon grand-père et qui s’était acquitté d’une partie de celles-ci en travaillant
pour sa fille aînée. Quant à la salle à manger et à la chambre à coucher de mes
parents, elles sortaient des ateliers artisanaux de Saint-Loup, avec lesquels
les Fougerollais ne pouvaient rivaliser, l’industrie lupéenne du meuble étant réputée pour l’excellence de ses
sculpteurs et la qualité de sa production de style. Même si de nos jours
l’artisanat lupéen a périclité, la renommée de
Saint-Loup a passé depuis longtemps les frontières, en particulier grâce à la
grande usine Parisot.
Le rappel de ces très anciens métiers du bois m’amène
tout naturellement à évoquer les activités principales de la famille Leyval, à savoir la scierie et la tonnellerie. Cependant je
crois qu’il est important de faire d’abord mention d’un autre métier jadis très
répandu à Fougerolles et dans sa région, à savoir la meunerie. Les nombreux
cours d’eau fournissaient aux moulins et aux scieries une énergie gratuite et
toujours renouvelée, qui de surcroît, et pour parler le langage actuel, était
parfaitement écologique. Il existait à Fougerolles-le-Château et aux environs
plusieurs moulins très anciens sur la Combeauté et
ses affluents, comme le moulin Saire et le moulin
Colle, où travaillait l’un des frères de ma grand-mère, François dit Lamy.
Mais celui qui nous intéresse le plus est le moulin du Pont, au centre de
Fougerolles. C’était l’un des trois moulins banaux des « Seigneurs et
Dames », et le plus important de tous, car il cumulait les activités de
meunerie, d’huilerie, de scierie et de papeterie. Après la Révolution, cette
propriété semble avoir changé de main plusieurs fois, jusqu’au moment où mon
grand-père François Leyval l’acheta à Nabord Mougin pour y installer sa
tonnellerie. Il loua le moulin, situé sur la rive droite du canal dans le
bâtiment le plus ancien, à Constant Dormoy, qui était auparavant meunier à la Gabiotte. Il reste de cette époque une carte postale sur
laquelle on reconnaît nettement le meunier au milieu d’une dizaine de
personnages. En 1895, la famille Dormoy quitta le Pont pour s’installer au
Château, un peu en amont de Fougerolles sur la Combeauté.
François Leyval continua à faire exploiter le moulin
du Pont par un farinier, de même que la scierie était confiée à un sagard,
terme vosgien emprunté à l’allemand Säger et
désignant l’exploitant d’une scierie. Jusqu’aux années 1930, le haut fer,
scie à lame verticale, fonctionnait dans un bâtiment situé entre la tonnellerie
et la rue. On l’appelait parfois le chalet suisse parce qu’il était en
grande partie construit en bois. Je l’ai toujours connu vétuste et passablement
décrépit, en particulier le hangar qui abritait la scie et qui est au centre
d’une carte postale datant probablement de la première Guerre mondiale. Cette
photographie présente une vue d’ensemble de la propriété Leyval,
avec le moulin, la tonnellerie et la scierie, devant laquelle on distingue deux
ouvriers, un soldat casqué et une dizaine d’enfants assis sur des grumes et des
piles de sciage.

C’est au milieu des années 30 que l’oncle Maurice
transporta la scie à la place de l’ancien moulin, qui avait été occupé quelque
temps par un voisin, le garagiste Eugène Leyval. Ugène, comme on l’appelait dans le quartier, n’avait
pas de lien de parenté avec nous. C’était un très brave homme, qui parlait avec
une remarquable lenteur. Il transféra son atelier de l’autre côté de la route,
le long de la rivière. Mon oncle m’embaucha pour l’aider au transport des
pièces de la scie jusqu’au nouveau local, à l’aide de palans, de crics, de câbles
et de chariots. Nous finîmes, après de longs efforts, par venir à bout des
engrenages, des arbres de transmission et d’autres pièces aussi lourdes
qu’encombrantes. C’est à la même époque qu’intervint le remplacement de la
grande roue hydraulique du moulin, qui depuis des lustres actionnait
les machines des ateliers. La plupart des palettes de cette roue à aubes étant
pourries, je pris un jour l’initiative de les briser et de les faire choir dans
l’eau du bief, jusqu’au moment où l’oncle Maurice me tança vertement, les
amusements puérils d’un gamin étant incompatibles avec un travail sérieux et
ordonné. La grande roue de moulin fut alors remplacée par une turbine, ce qui
était nettement moins poétique, mais plus moderne. J’ignorais alors que ce
genre de roue avait été un siècle auparavant l’un des thèmes d’inspiration des
écrivains romantiques et qu’avec la turbine nous passions d’un coup à l’ère
industrielle.
Je dois tout de même préciser qu’en l’occurrence la
modernité se limitait à la turbine. À la scierie, le machinisme était à peu
près inconnu et la majeure partie du travail s’effectuait à la force des bras.
Le métier de sagard était très pénible, en particulier l’hiver, car les
vastes locaux étaient à peu près impossibles à chauffer. Seul un poêle à sciure
dispensait un peu de chaleur…dans son voisinage immédiat. Pour ne pas geler par
grand froid, mon oncle portait des moufles et montait de temps en temps dans sa
cuisine pour y avaler un café et le traditionnel verre de kirsch…
Le sciage du bois était l’aboutissement d’un long
processus qui débutait par l’adjudication des coupes. La vente des bois avait
lieu à Luxeuil en septembre, sous la responsabilité
des Eaux et Forêts. Tous les marchands de bois se rendaient à ces ventes aux
enchères, qui représentaient un moment particulièrement important de l’année.
Le négociant y conviait parfois ses cautions et les invitait à déjeuner au
restaurant. C’est ainsi que mes parents y accompagnaient l’oncle Edmond et que
je garde un bon souvenir de ce qui était pour moi une sorte de fête.
La phase suivante consistait à estimer le volume des
arbres sur pied, à procéder au cubage de ceux qui devaient être abattus. Le
négociant utilisait pour cela des appareils de mesure spéciaux dont j’ai vu
jadis des exemplaires chez ma grand-mère.
Puis des équipes de bûcherons intervenaient, de
solides gaillards qui travaillaient à la cognée et au passe-partout. Les troncs
ébranchés gisant au sol étaient ensuite débités sur place ou transportés dans
les scieries. Dans le premier cas, les scieurs de long entraient en jeu. Ils
accomplissaient un travail très dur, qui consistait à découper les grumes dans
le sens de la longueur, à l’aide d’une grande scie à refendre, pour en tirer
des pièces longues et épaisses. C’est ainsi que les scieurs de long de l’oncle
Edmond, souvent des immigrés portugais, fabriquaient les traverses pour les
voies ferrées. Dans le second cas, les voituriers entraient en lice avec leurs
attelages de bœufs. Ils chargeaient – avec quels efforts – les billes de chêne
sur les camsures et les débardaient grâce à
trois ou quatre paires de bœufs. Il reste de ces travaux herculéens des cartes
postales et des photographies impressionnantes.

 Lentement
mais sûrement, les troncs d’arbres étaient acheminés vers la scierie Leyval, déchargés avec des crics sur le chantier et entreposés
là en attendant d’être débités. Certaines familles de cultivateurs étaient
spécialisées dans le débardage, comme la famille Deshayes,
les Méris des Chavannes, qui étaient
apparentés par mariage à la tante Madeleine et travaillaient beaucoup pour la
maison Leyval.
Lentement
mais sûrement, les troncs d’arbres étaient acheminés vers la scierie Leyval, déchargés avec des crics sur le chantier et entreposés
là en attendant d’être débités. Certaines familles de cultivateurs étaient
spécialisées dans le débardage, comme la famille Deshayes,
les Méris des Chavannes, qui étaient
apparentés par mariage à la tante Madeleine et travaillaient beaucoup pour la
maison Leyval.
Le moment venu, l’oncle Maurice ou son ouvrier
préparait la bille destinée au sciage. À l’aide d’une sorte de cognée, il
enlevait les aspérités du tronc, les moignons de branches et une partie de
l’écorce. Si la bille devait être raccourcie, il fallait avoir recours au
passe-partout. Quand personne d’autre n’était disponible, mon oncle
m’embauchait pour l’aider. C’était un travail éreintant pour le dos et les
bras. Quand la bille était prête, il restait à la transporter jusqu’au haut
fer, ce qui n’était pas non plus de tout repos. On utilisait un diable, sorte
de chariot à deux roues muni d’un long timon qui permettait de faire levier
pour soulever la bille, attachée entre les roues avec des chaînes. Il y avait
trois diables de tailles différentes à la scierie, selon le poids du tronc à
déplacer. La difficulté principale était de faire rouler le diable sur un sol
raboteux. Mon oncle mobilisait alors toutes les bonnes volontés, y compris mes
tantes, qui s’arc-boutaient aux roues du diable. Une fois rendue devant la
scie, la bille devait encore être déposée sur le chariot du haut fer et mise
soigneusement en place, ce qui se faisait grâce aux crics et à une espèce de
croc dont j’ai oublié le nom. On imagine la somme d’efforts qu’il fallait
déployer avant de procéder au sciage.
Les planches étaient ensuite entreposées par piles sur
le chantier. La sciure, accumulée dans une fosse sous la scie, servait à divers
usages, notamment à chauffer les locaux. À côté du haut fer, mon oncle avait un
établi sur lequel il affûtait les lames avec diverses limes venant en général
de l’usine Magot de Vesoul. Dans le fond de ces vastes locaux, il avait
installé un autre établi, beaucoup plus long, donnant sur le jardin et muni
d’une quantité d’outils à bois et à métaux. C’est là que je passais des heures
à bricoler et à m’initier au travail manuel, toujours sous la surveillance de
mon oncle.
L’importance du travail du bois dans la vie fougerollaise est encore perceptible aujourd’hui. Elle est
soulignée par les nombreuses cartes postales et photos consacrées à ces
activités. On peut y découvrir les membres de la famille Leyval,
posant devant la scierie ou la tonnellerie, l’oncle Maurice dans son éternel
pantalon de charpentier en velours et sa chemise à manches longues, mes tantes,
et ma mère assise sur un tronc d’arbre ou sciant du bois avec une voisine.

Sans compter beaucoup d’autres personnages, pris sur
le vif en plein travail et dont les noms m’échappent.
L’oncle Maurice n’était pas un fanatique de la
productivité. C’était dans son genre un philosophe de l’existence, qui donnait
la priorité aux relations humaines et aux travaux de la terre. À la belle
saison, il était souvent inutile de le chercher à la scierie. Un écriteau placé
à l’entrée indiquait qu’il était au jardin ou en train de cueillir des fruits.
En tant que conseiller municipal, il connaissait tout le monde et recevait en
toute saison une foule de visiteurs. Les pauses étaient donc innombrables, ainsi
que les dégustations de kirsch et les tournées de bière dans les cafés du
quartier. Pour mes autres oncles, habitués à un travail organisé et assidu,
cette manière de vivre pouvait sembler choquante. J’en garde, quant à moi, un
bon souvenir, car je la trouvais pleine de charme, en opposition absolue avec
la vie que j’étais obligé de mener à l’internat du lycée de Vesoul, déjà si
redouté de l’oncle Henri.
La scierie fournissait tout de même assez de bois à la
tonnellerie, qui travaillait au rez-de-chaussée de ma maison natale, sur la
rive gauche du bief. Si Fougerolles a connu un extraordinaire essor de cette
branche de l’artisanat au 19ème siècle, la fabrication des tonneaux
était loin d’être nouvelle puisqu’elle figure déjà sur les stèles
gallo-romaines de Luxeuil.
Avec plus de vingt ouvriers, l’entreprise de mon
grand-père était l’une des tonnelleries les plus importantes de la région, à
côté de celles de son ami Eugène Ougier, d’Henri
Robert, des Frères Saguin et des distilleries Bresson
et Lemercier. Le vaste atelier, que l’on nommait toujours la boutique comme le
faisaient les Compagnons du Tour de France, occupait tout le bas de la maison.
Les établis étaient alignés le long des fenêtres, donnant sur le chemin qui
menait vers les prés. Les bancs d’âne, appelés selles à tailler en français et quégnates
en patois, étaient l’une des caractéristiques les plus typiques de l’outillage.
Le machinisme était limité à une raboteuse, une scie à ruban et une meule
actionnées par la grande roue du moulin, puis par la turbine. Sinon tout le
travail s’effectuait manuellement, y compris l’affûtage des outils avec une
grande meule de grès installée le long du canal de la maison Lemercier frères.
Derrière la boutique se trouvait un petit hangar en bois, près de la
passerelle qui menait au jardin. C’était là que travaillait le merrandier, l’ouvrier qui préparait le merrain. Sur un
billot à trois degrés, en forme d’escalier, il débitait les quartiers de chêne
à la hache, puis au départoir,
appelés selles à tailler en français et quégnates
en patois, étaient l’une des caractéristiques les plus typiques de l’outillage.
Le machinisme était limité à une raboteuse, une scie à ruban et une meule
actionnées par la grande roue du moulin, puis par la turbine. Sinon tout le
travail s’effectuait manuellement, y compris l’affûtage des outils avec une
grande meule de grès installée le long du canal de la maison Lemercier frères.
Derrière la boutique se trouvait un petit hangar en bois, près de la
passerelle qui menait au jardin. C’était là que travaillait le merrandier, l’ouvrier qui préparait le merrain. Sur un
billot à trois degrés, en forme d’escalier, il débitait les quartiers de chêne
à la hache, puis au départoir, enfin
au coutre
enfin
au coutre pour
façonner la future douelle, terminée ensuite à la plane
pour
façonner la future douelle, terminée ensuite à la plane sur
le banc d’âne par le tonnelier.
sur
le banc d’âne par le tonnelier.
Je me souviens particulièrement de Lamiche,
le merrandier qui resta quelques années chez Leyval. C’était un homme au visage coloré et avenant, qui
nous appelait « compagnons », car les traditions du compagnonnage
étaient toujours vivaces chez les tonneliers.
Les piles de merrain s’entassaient sur le chantier qui
s’étendait derrière la maison, entre les deux canaux. Les fûts terminés étaient
stockés à l’abri. Pour réaliser tous ces travaux, « nos hommes »,
comme on les appelait dans la famille, arrivaient parfois avant six heures du
matin à l’atelier, et en repartaient souvent à dix-neuf heures. Ils venaient à
pied, parfois de hameaux éloignés. L’un d’entre eux, Julien, habitait près du Moulin
Bakâ, dans la vallée de l’Augronne.
Il faisait plus de deux heures de marche par jour. Certains venaient même
travailler le dimanche matin, quand ils avaient de l’ouvrage à finir. Ils
étaient payés à la pièce. Mais comme l’oncle Maurice, ils tenaient à leur
liberté et restaient chez eux quand ils avaient un cochon à tuer, un jardin à
bêcher ou des cerises à récolter. Ils bougonnaient quand ils avaient un peu bu,
mais ne faisaient pas grève, sauf une fois. Mon grand-père leur donna un tonneau
de vin, et la grève s’arrêta. Ces gens-là étaient accoutumés au labeur et
vivaient de peu. Ils s’appelaient Paul Franc, Jousé
Richard, Philibert, Pété, Le Fiosse, Badof. Il y avait aussi Léon du Kâ
et son frère Fanfois du Kâ,
Eugène de chez Ginie et son frère Le Chaille, et
aussi La Puce. Je ne connaissais de beaucoup d’entre eux que leur sobriquet.
Tous ou presque avaient appris le métier avec François Leyval.
 De mon
temps, il ne restait de toute l’équipe que le dernier carré, moins d’une
demi-douzaine d’ouvriers qui travaillaient encore pour la tante Gabrielle sous
la direction de Paul Franc, son homme de confiance. Je garde d’eux une très
belle photo, prise à la porte de la boutique, avec en particulier les
tantes Alice et Madeleine, Paul Franc, Lamiche et
d’autres tonneliers avec leurs grands tabliers.
De mon
temps, il ne restait de toute l’équipe que le dernier carré, moins d’une
demi-douzaine d’ouvriers qui travaillaient encore pour la tante Gabrielle sous
la direction de Paul Franc, son homme de confiance. Je garde d’eux une très
belle photo, prise à la porte de la boutique, avec en particulier les
tantes Alice et Madeleine, Paul Franc, Lamiche et
d’autres tonneliers avec leurs grands tabliers.  Dans
les années 20 et 30, je les entendais taper sur leurs tonneaux dès six ou sept
heures du matin, car les chambres étaient au-dessus de l’atelier. À 8 heures,
ils déjeunaient de tartines de fromage blanc et de lard. À midi, ils mangeaient
la soupe, les pommes de terre et les haricots apportés dans leur pot de camp. À
4 heures de l’après-midi, ils mouérandaient
(goûtaient) d’un morceau de cochon et de fromage, toutes ces victuailles étant
tirées du sac.
Dans
les années 20 et 30, je les entendais taper sur leurs tonneaux dès six ou sept
heures du matin, car les chambres étaient au-dessus de l’atelier. À 8 heures,
ils déjeunaient de tartines de fromage blanc et de lard. À midi, ils mangeaient
la soupe, les pommes de terre et les haricots apportés dans leur pot de camp. À
4 heures de l’après-midi, ils mouérandaient
(goûtaient) d’un morceau de cochon et de fromage, toutes ces victuailles étant
tirées du sac.
Comme les scieurs, ils avaient leurs cafés attitrés,
de l’autre côté de la rue, d’abord chez Chipeaux,
puis chez Adrienne Guyot. Ils buvaient du chien, eau-de-vie dédoublée,
et de la bière du Val d’Ajol, de la brasserie La
Gerbe d’Or. Le vin ne se répandit qu’après 1918, comme on peut le voir sur
une photo prise devant le café Chipeaux, où Paul
Franc, Philibert et les autres sont attablés en chemises blanches, grands
tabliers et sabots.
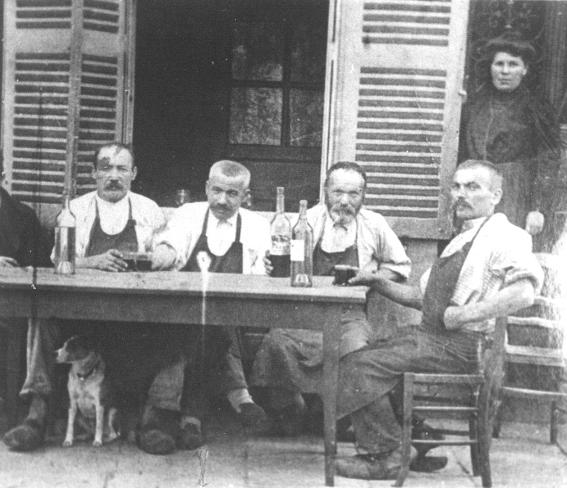
Ces hommes avaient bien droit de temps en temps à une
pause, étant donné leur labeur quotidien et la longueur de leur journée de
travail. J’ai dit plus haut que je les entendais dans un demi-sommeil frapper
sur leurs tonneaux à des heures matutinales. La confection d’un fût était en
effet chose compliquée. Les douelles préparées par le merrandier
devaient être d’abord tirées à la plane sur le banc d’âne, évidées à
l’intérieur, passées à la colombe, que l’on appelait en patois jeandou, afin de rectifier les joints. Suivait le
montage des douves avec les cercles du dessus, qui avait lieu devant la boutique,
sur une grande pierre circulaire de grès. Les tonneliers allumaient sous le
tonneau un feu de copeaux tout en aspergeant d’eau les douelles à cintrer, qui
se courbaient progressivement grâce au cabestan. Les cercles, préalablement
rivés à coups de marteau sur une petite enclume nommée bigorne,
 étaient ensuite mis en place avec la chasse,
outil permettant de les faire glisser peu à peu autour du fût. Celui-ci ayant
pris forme, il fallait encore procéder à plusieurs opérations. L’intérieur
était raboté au rognoir, sorte de rabot en forme de pioche. Pour mettre en
place les fonds, en les enchâssant dans le jable, rainure pratiquée dans les
douves avec le trusquin
étaient ensuite mis en place avec la chasse,
outil permettant de les faire glisser peu à peu autour du fût. Celui-ci ayant
pris forme, il fallait encore procéder à plusieurs opérations. L’intérieur
était raboté au rognoir, sorte de rabot en forme de pioche. Pour mettre en
place les fonds, en les enchâssant dans le jable, rainure pratiquée dans les
douves avec le trusquin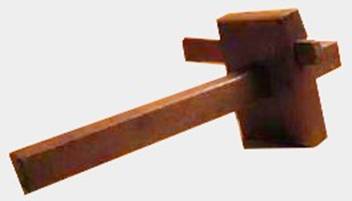 , dit grévou en patois. On n’oubliait pas de rendre les
joints étanches avec du jonc ou de la farine de seigle, de percer les trous
pour la bonde et le robinet, d’araser et de raboter proprement les douelles et
les fonds. Et finalement de vérifier l’étanchéité du tonneau en y versant de
l’eau chaude sur des cristaux de soude.
, dit grévou en patois. On n’oubliait pas de rendre les
joints étanches avec du jonc ou de la farine de seigle, de percer les trous
pour la bonde et le robinet, d’araser et de raboter proprement les douelles et
les fonds. Et finalement de vérifier l’étanchéité du tonneau en y versant de
l’eau chaude sur des cristaux de soude.
Un bon tonnelier pouvait réaliser, sans pertes de
temps, deux tonneaux par jour, mais il fallait de l’endurance pour s’escrimer
dix ou douze heures durant sur des morceaux de chêne aussi coriaces que de la
pierre. J’ai toujours admiré la manière dont ces simples ouvriers, qui avaient
appris leur métier sur le tas, parvenaient à produire des objets proches de la
perfection, et en tout cas parfaitement adaptés à leur utilisation. Mais à
l’époque de mon grand-père ils se surpassaient par l’élaboration non plus
seulement des fûts, mais des foudres. Il reste de ce temps-là une carte postale
destinée à la publicité de la maison F. Leyval
« Fûts et Foudres en tous genres – Spécialité de chantiers – Scierie
hydraulique ».
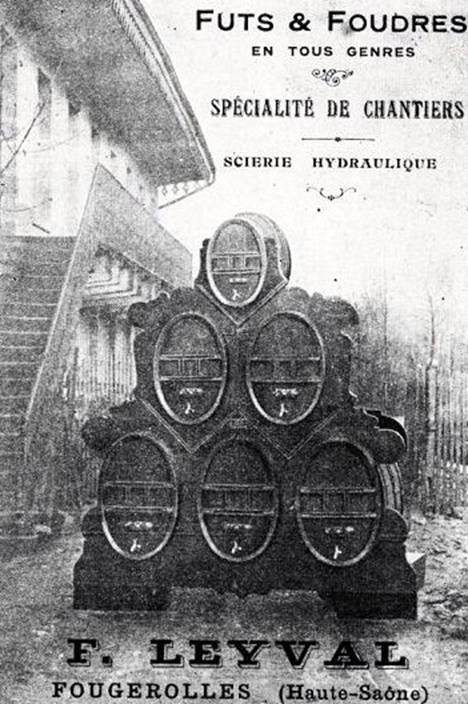
Elle montre un magnifique ensemble de six tonneaux
ovales intégrés à un bâti en bois très travaillé, comme on peut en voir encore
dans les grandes caves de Bourgogne ou de Rhénanie. Ces chantiers, souvent
ornés de sculptures, sont aujourd’hui de véritables pièces de musée. Ma mère
m’a souvent raconté que leur achèvement était l’occasion de fêtes dans le cadre
de la famille, de l’entreprise et du voisinage.
Je n’ai connu que l’ultime reflet de cette belle
époque. La tante Gabrielle maintint tant bien que mal la tonnellerie jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale. De tout cela, il ne reste plus qu’un atelier vide,
quelques outils et un établi dont je me sers encore, des photos et des
souvenirs de plus en plus lointains, en particulier celui des gros marteaux
frappant sur les cercles et les enclumes.
Avant de terminer cette évocation d’une époque qui
semble à présent préhistorique, je voudrais mentionner deux photos de groupes
représentant deux équipes de tonneliers, qui étaient probablement les ouvriers
de mon grand-père. Je présume que ces photos ont été prises dans l’atelier du
bas de l’Aval, mais il m’est naturellement impossible de reconnaître les
personnages qui y figurent, sauf deux qui sont au premier rang. Je suppose,
comme je l’ai déjà écrit précédemment, qu’il s’agit de mon grand-père et de l’oncle
Henri, qui était alors un jeune garçon. En tout cas, ces photographies, qui
montrent les tonneliers brandissant leurs outils parmi les tonneaux et les bancs
d’âne, sont extrêmement évocatrices.
Il convient de rappeler qu’outre le moulin, la scierie
et la tonnellerie, deux autres formes d’artisanat étaient représentées dans les
locaux de la maison Leyval : la forge et la
carrosserie. Le premier de ces métiers était exercé par un maréchal-ferrant
nommé Grosjean, dont le fils travailla plus tard à la scierie avec l’oncle
Maurice. Le second était la spécialité de la famille Émourgeon,
dont un descendant habitait Dijon. Il était né, comme ma mère et moi, dans la
maison Leyval.
L’une des principales activités de Fougerolles, la
vannerie, n’était pas présente chez Leyval. Elle
occupait dans la localité autant de monde que la tonnellerie, soit plus de 200
personnes, essentiellement à l’emballage des bonbonnes. L’une des entreprises
les plus importantes était celle de Lemercier frères, proche voisine de la propriété
Leyval, puisque nous en étions séparés par le canal
qui longeait la tonnellerie. Du chantier de merrain, je pouvais apercevoir les
pyramides de bonbonnes amenées jusque-là grâce à un embranchement ferroviaire
desservant l’usine. Les ouvriers passaient leurs journées à mettre ces
récipients de verre dans leurs paniers d’osier. D’autres faisaient du clissage,
c’est-à-dire tressaient l’osier à même le verre. Dois-je avouer que j’avais la
tentation de tirer avec ma fronde dans ces énormes pyramides de bonbonnes ?
Encore quelques mots sur un genre d’activité auquel
j’ai déjà fait allusion et qui occupait la très grande majorité des femmes de
la région, je veux dire la broderie. Selon les estimations, 50 000 ouvrières
travaillaient après 1918 aux divers types de broderie : dentelle au
crochet, filet d’art, Venise, dentelle de Luxeuil,
passementerie. Le travail se faisait soit dans les ateliers des entreprises,
soit à la maison, souvent en groupe autour du poêle en hiver, sur le pas de la
porte en été. C’était la plupart du temps un travail d’art, long et délicat,
dans lequel excellaient certaines brodeuses du pays. Leurs productions se
vendaient en particulier aux curistes de Plombières et de Luxeuil,
ou aux magasins spécialisés de Paris. Toutes les vieilles familles fougerollaises possèdent encore, empilées dans leurs
armoires, des draps, des nappes et des serviettes superbement travaillés par
telle ou telle parente experte en broderie. Avec l’eau-de-vie, ces
chefs-d’œuvre ont fait la réputation de la région.
La famille Leyval
participait à cette activité originale, que l’on peut qualifier d’artistique.
J’ai toujours vu mes tantes passer quelques heures par jour à broder sur leur
tambour, la tante Gabrielle à ses moments de loisirs dans son bureau, la tante
Madeleine dans sa cuisine au-dessus de la scierie. À la belle saison, ces
travaux se faisaient sur le balcon de la tonnellerie. La plus habile était ma
tante Marie-Louise, qui était aussi ma marraine. Avant d’entamer une carrière
d’institutrice dans les années 1920, elle avait travaillé dans la maison de
couture Deville, à Fougerolles, et elle avait des dons remarquables de
décoratrice du linge de table.
Grandeur et décadence de l’artisanat fougerollais : ce que j’ai vécu entre les deux guerres
n’était plus que la dernière phase d’une évolution beaucoup plus générale des
techniques, des modes de vie et des mentalités. La Belle Époque avait marqué le zénith du monde artisanal. Je n’en ai
connu que le crépuscule, mais, pour citer Nietzsche, « il y a de la grandeur, du sublime dans les mondes qui
s’effondrent…des douceurs aussi, des espérances et des couchers de soleil
empourprés ».
Autour de moi, dans la famille, personne ne semblait
s’en préoccuper outre mesure, mais chacun avait la nostalgie des temps révolus et
conservait pieusement les souvenirs du passé.
Le recul historique permet aujourd’hui de mesurer le
chemin parcouru depuis la mort brutale du grand-père, il y a exactement un
siècle, et l’effondrement récent de l’ancien moulin banal du Pont, écroulement qui
est le signe tangible de la phase finale du déclin.