Chapitre 14
Épreuves et espoirs (1943-1944)
L'encerclement de la 6ème
armée allemande à Stalingrad laissait présager de bonnes nouvelles pour le
début de 1943. En vérité, elles étaient bonnes pour nous, non pour les
Soviétiques et les Allemands de vingt ans qui mouraient chaque jour par
milliers dans les neiges de Russie. Le général Paulus finit par capituler le 31
janvier malgré les admonestations d'Hitler, qui le promut maréchal et décréta
un deuil national de plusieurs jours. La fin de la bataille de Stalingrad
marqua le tournant de la guerre. Désormais, le Reich était sur la pente
descendante. La propagande nazie réagit par la voix de Goebbels, qui, le 18
février au Palais des Sports de Berlin, proclama la « guerre totale », en fait l'avènement d'un système de
plus en plus totalitaire.
Dans les pays occupés, les
répercussions furent immédiates. Laval décréta le 15 février la création du Service
du Travail Obligatoire, qui en réalité ne signifiait rien d'autre que la
déportation de travailleurs forcés. La relève
s'étant révélée insuffisante, le grand pourvoyeur en main d'œuvre, le Gauleiter
Sauckel réclamait du gouvernement de Vichy 250 000 hommes par trimestre.
Le zèle des collaborateurs français
alla encore plus loin. Le 30 janvier 1943, Laval créa la Milice, aile
extrémiste de la Légion des Combattants. Son chef était le sinistre
Joseph Darnand, membre des Waffen-SS. D'autres encore se préparaient à aller combattre sur le front de l'Est, tel Jacques Doriot à la
tête de ses Gardes Françaises. La guerre des ondes s'aggravait entre
Londres (Les Français parlent aux Français) et Radio Paris (Radio
Paris ment, Radio Paris est allemand) ou Radio Vichy avec son éditorialiste
Philippe Henriot.
La guerre totale signifiait aussi une pénurie de plus
en plus grande de produits alimentaires et de biens de consommation courants. À
la campagne et grâce à mon père, nous arrivions à nous nourrir assez
correctement, mais nous manquions absolument de caoutchouc, c'est-à-dire de
pneus. Or le vélo était à peu près notre seul moyen de déplacement… Je
recousais mes pneus avec une alène de cordonnier, mais c'était un remède bien
dérisoire. D'autres roulaient sur des bouchons de liège enfilés sur un cercle
en fil de fer autour de la jante. C'était la solution qu'avait choisie mon
camarade François Jamey, qui venait ainsi chaque semaine de Scey-sur-Saône à
Vesoul pour prendre le car de Besançon. Alors que je déposais mon vélo chez
Nicole Nouveau, il laissait le sien chez notre camarade Paulette Régent, la
future Madame Dufils, dont les parents étaient instituteurs à Échenoz.
Les autorités ayant décidé que le STO
serait de deux ans et concernerait notamment les classes 1940, 1941 et 1942,
nous vivions désormais avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il fallait
pourtant bien continuer à travailler pour les examens de faculté, essayer
d'obtenir quelques résultats avant d'être exclus de l'université. Dans ces
circonstances difficiles, il y avait pourtant un heureux changement : depuis
novembre 1942, nous étions admis, François et moi, au Centre d'accueil des
étudiants, foyer situé derrière le rectorat, non loin de l'archevêché. À
défaut de cité universitaire, celle-ci étant toujours occupée par les
Allemands, ce modeste centre offrait à quelques dizaines d'étudiants le
logement gratuit et des locaux convenablement chauffés. De plus, au lieu de
nous morfondre dans des chambres glaciales, nous vivions en communauté, ce qui
créait une ambiance relativement joyeuse malgré les circonstances. Les
distractions en ville étant à peu près inexistantes, nous détendions
l'atmosphère grâce à des farces de potache, des histoires drôles et des
chansons d'étudiants. Le centre avait pour directeur M. Préclin, historien à la
faculté des Lettres et professeur de François Jamey. Ce brave homme venait assez
souvent contrôler notre travail, interrompant parfois une séance de chahut dont
il ne nous tenait pas rigueur, car il savait bien que nous devions nous
défouler de temps en temps.
Nous déjeunions toujours au Petit
Polonais, où la pitance était de plus en plus mauvaise, mais la bonne
humeur toujours au rendez-vous. Notre groupe comprenait essentiellement
François et moi, ainsi que trois étudiants en médecine : Daniel Gaussin, de
Vesoul, Jacqueline Marti, de Montbéliard, et le fils d'un instituteur de Lure
qui s'appelait Juif. J'ai conservé de ce groupe quelques petites photos prises
dans les rues de Besançon.


Nous sortions parfois pour fréquenter
les brasseries, mais depuis le départ des troupes allemandes vers l'Est, ces
établissements paraissaient vides, et les étudiants ne suffisaient pas à les
remplir. Il nous arrivait également d'aller au théâtre assister à quelque
représentation ou à quelque concert de piano ou de violon. Cependant le cinéma
était pour nous la principale source de culture, si toutefois on peut qualifier
de culturelles les productions de la propagande allemande ou vichyste. Le
fameux film antisémite Le Juif Süss l'était fort peu. Par contre, Les
visiteurs du soir de Marcel Carné, sorti fin 1942, fit grand effet sur
nous.
Au printemps, le travail de
préparation des examens coïncida avec des événements de première importance,
comme la capitulation de l'Afrikakorps et la création, le 27 mai, par Jean
Moulin, du Conseil National de la Résistance. En juin, Jean Moulin fut arrêté à
Caluire. Le 5 juin, je passai le certificat d' Études
pratiques d'Allemand, y compris l'oral d'anglais qui consistait à traduire une
page de Croc-Blanc (White Fang) de Jack London. L'examinateur, un
professeur du Lycée Victor Hugo, me posa quelques questions auxquelles je
répondis tant bien que mal. Je ne savais en anglais que ce que j'avais appris
aux cours particuliers de Pitche, un angliciste de Vesoul, et de M. Warren, un
Américain. À cette époque, les anglophones ne couraient pas les rues et les
occasions de parler la langue de Shakespeare étaient rarissimes.
J'aurais pu espérer obtenir mon
dernier certificat, celui de littérature, en octobre 1943, mais nos gouvernants
en avaient décidé autrement. La date de notre départ pour l'Allemagne était
fixée à fin juillet. Je subis préalablement, le 23 juin, un examen d'interprète
de langue allemande, conformément à une circulaire ministérielle du 7 juin
1943. Un certificat signé par le Doyen Préclin me fut délivré quelques jours
après.
À peine sorti de la faculté après cet
examen, j'eus précisément l'occasion de prouver ma connaissance de la langue de
Goethe. À peine étais-je installé dans le car de Vesoul qu'une patrouille de la
Feldgendarmerie, la police militaire, se mit à contrôler les papiers
d'identité. Or les miens, je ne sais plus pourquoi, n'étaient pas en règle.
J'expliquai aux hommes au "collier de chien", comme les Français les
appelaient souvent, que je venais de passer un examen d'interprète, ce qui
était vrai, et que j'étais sur le point de partir au STO, ce qui ne l'était
pas. Visiblement persuadés par mon discours, les policiers n'insistèrent pas.
Cela prouve une nouvelle fois que dans certains cas la connaissance de la
langue de l'adversaire n'était pas inutile.
En juin, ma décision était prise : je
n'irais pas au STO. Il en était de même pour beaucoup de mes camarades. Nous
avions à la campagne des possibilités de survie clandestine qui n'existaient
pas dans les grandes villes. L'environnement et la solidarité campagnarde
jouaient un rôle primordial, en particulier parce que mon père s'arrangeait
pour fournir des tickets de ravitaillement aux réfractaires. Il avait déclaré
que, fût-il révoqué de son poste d'instituteur, il ne nous laisserait pas
partir en Allemagne.
Il restait à trouver des
"planques" adéquates. Mes camarades de Quincey se préparaient à
s'éclipser à quelques kilomètres, du côté de Vallerois-le-Bois, ce qui entre
parenthèses signifiait la fin de notre association sportive le Sporting Club
Frotéen. Mais ce n'était rien à côté des problèmes existentiels auxquels
nous étions confrontés.
Après réflexion, nous décidâmes, mes
parents et moi, de demander asile à notre parenté fougerollaise, d'une part à
mes oncles et tantes, d'autre part à nos cousins du Sarcenot. Pourquoi
précisément ce hameau éloigné, blotti dans la forêt à la limite du département
des Vosges ? Il y avait, je crois, plusieurs raisons à ce choix. D'abord une
raison sentimentale, car c'était le lieu de naissance de mon grand-père
François Leyval et le terroir où s'était établie sa famille quand elle était
venue des Granges de Plombières. Les Leyval du Pont avaient toujours eu, comme
je l'ai déjà mentionné, une certaine prédilection pour ce berceau familial. S'y
dissimuler était en somme un retour aux sources et une assurance de sécurité.
La situation géographique du coin inspirait également confiance. Ces fermes
isolées dans la forêt à l'écart des grandes routes pouvaient facilement abriter
des clandestins. Enfin il y avait une autre raison déterminante : l'existence
au lieu-dit Chez le moine d'une maison vide, celle de ma grand-tante
Joséphine.
Voilà donc pourquoi je me rendis dans
le courant de juin avec ma mère chez nos cousins Lemercier, qui habitaient un
peu plus loin, le long de la pente qui surplombe la vallée de l'Augronne, au
lieu-dit Chez Grigard. Il y avait là les parents Victor et Hermine la
cousine germaine de maman, les deux fils René et Charles, les deux filles
Jeanne et Charlotte, ainsi qu'une autre Jeanne, l'épouse de René, originaire du
Val d'Ajol.
Ma mère exposa sa requête, qui fut aussitôt acceptée.
Nos braves cousins ne firent même aucune difficulté quant à l'accueil de trois
autres réfractaires : mon ami François Jamey, notre camarade Lucien Pichery,
fils du percepteur de Scey-sur-Saône, et Jean Beugnot, qui habitait près de
Remiremont et était le cousin de Paulette Régent.
Je ne saurais trop insister sur le dévouement,
l'abnégation et le courage dont ont fait preuve à cette époque dramatique nos
cousins Lemercier. Je leur en ai aujourd'hui encore la plus vive gratitude. Le
risque qu'ils prenaient n'était pas mince, car nul ne savait comment les choses
allaient évoluer.

Retourné à Quincey, je me préparai
activement à prendre le maquis. Entre-temps, Robert Depoulain, le père de mon
camarade de classe Martial, avait apporté à mes parents une fausse carte
d'identité que je garde toujours en souvenir. Nous verrons par la suite quelles
conséquences tragiques entraîna le réseau vésulien de distribution de ces
fausses cartes.
Peu après le 20 juillet, je reçus du
recteur une circulaire comminatoire, m'intimant l'ordre de me rendre à la
caserne Lecourbe à Besançon, faute de quoi je serais exclu de l'université et
déclaré inapte à toute fonction publique. La lettre se terminait par la phrase
suivante : « J'espère que la
jeunesse universitaire de Besançon fera son devoir. »
Les dés étaient jetés, mais nous
étions quand même dans un certain état de perplexité. Je savais par mon
camarade Camille Magnien, parti travailler à Hambourg en 1942, combien
terribles étaient les bombardements dans les grandes villes allemandes. Et d'un
autre côté, mon camarade Pierre Cote, qui était à Vienne, rapportait des
rumeurs inquiétantes sur ce qui se passait dans les camps de concentration.
Réflexion faite, et avec le recul
historique qui est le nôtre aujourd'hui, notre décision de disparaître dans la
nature était, sinon la meilleure, en tout cas la moins mauvaise. Nous nous
retirâmes, mes camarades et moi, vers la fin juillet dans notre refuge
fougerollais, naturellement dans l'ignorance totale du sort qui serait le nôtre
par la suite. Nous nous demandions, entre autres choses, quelle serait la
réaction des autorités, tant allemandes que françaises. Il apparut assez vite
que les premières laissaient aux secondes le soin de s'occuper de l'affaire.
C'est ainsi que dans le courant de l'été un gendarme de Fougerolles vint à la
scierie interroger mon oncle Maurice à mon sujet. J'appris ainsi qu'une sorte
de mandat d'amener avait été lancé contre moi et que la gendarmerie
questionnait, à Nancy et ailleurs, un certain nombre de membres de la famille.
Comme je me trouvais sur place, le gendarme fut invité par mon oncle à venir me
rencontrer à la tonnellerie, où nous bûmes ensemble le traditionnel verre de
kirsch. À la fin de l'entretien, l'homme rentra à la gendarmerie et certifia
que personne ne m'avait vu… Après quoi je n'entendis plus parler de rien.
Cette histoire prouve que si la
police française de l'époque a parfois collaboré avec l'occupant, elle a aussi
souvent pris ses responsabilités et fait preuve de courage, à l'unisson de la
grande majorité de la population. L'intégration des nombreux réfractaires qui
se camouflaient dans la commune de Fougerolles se fit, à ma connaissance, sans
grande difficulté. Les Fougerollais avaient, depuis toujours, fait preuve
d'esprit d'indépendance et rejeté les iniquités du pouvoir.
Le pouvoir, précisément, ne se
manifesta plus qu'une fois à mon sujet, lorsque le 11 octobre le recteur de
Besançon transmit à mes parents une circulaire d'Abel Bonnard, ministre de l'Éducation
Nationale, qui demandait quelle était mon adresse en Allemagne afin de pouvoir
améliorer ma « situation matérielle
et morale »…
En attendant, ma situation n'était
pas idéale, puisque administrativement je n'existais plus, mais elle était
supportable. Je m'étais organisé pour passer une partie de la semaine à la
scierie et le reste au Sarcenot, où je montais à pied par les chemins et les
sentiers détournés du Château, du Bout, du Prémourey et de Beaumont.
J'apportais à mes compagnons des provisions, des messages, des nouvelles. Je
leur amenais même des visiteurs. Comme le dira François Jamey beaucoup plus
tard dans son ouvrage Autour de quelques souvenirs d'enfance et de jeunesse,
on venait voir les réfractaires un peu comme des animaux dans un zoo !
Si j'ai bonne mémoire, les premiers
qui se déplacèrent furent les deux Sceycolais Jean Rance et Jacques Poinsotte,
nos anciens camarades de classe. À ma connaissance, ils ne montèrent pas au
Sarcenot, mais restèrent à la scierie à deviser, dans les prés derrière le
chantier, avec François et moi. Quelques jours après, le 29 juillet, Jean Rance
fut arrêté par les Allemands chez lui, à Scey-sur-Saône, pour usage d'une
fausse carte d'identité. Un autre de nos camarades de classe, Marcel Dufils,
fut arrêté le même jour et pour la même raison. Le tribunal militaire condamna
Marcel à huit mois de prison, et Jean à quatorze mois, qu'il effectua surtout à
Francfort, et jusqu'à la capitulation de l'Allemagne.
Peu de temps après, nous reçûmes la
visite de deux autres amis, Claude Hasselot et Pierre Jeannin, que je guidai
par mes sentiers préférés jusqu'à notre repaire. Ils étaient alors en khâgne à
Louis-le-Grand et discutèrent tout le long du chemin du problème de savoir si
la philosophie était ou non une logomachie. Étant un peu plus jeunes que nous,
ils n'étaient pas astreints au STO et étaient exempts de tous les problèmes qui
pesaient sur notre vie quotidienne. De cette brève visite, il reste deux belles
photographies : Claude Hasselot, Pierre Jeannin, Lucien Pichery, François Jamey
et moi, assis sur des rochers dans la forêt du Sarcenot.
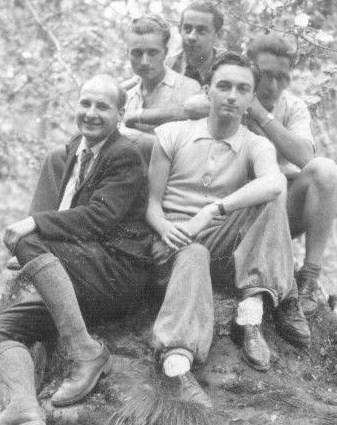
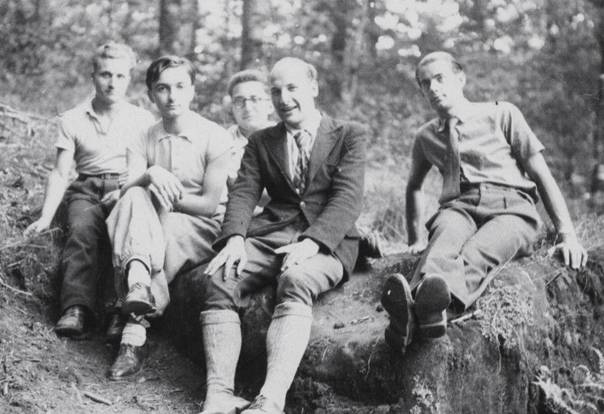
Vers cette époque, en août ou
septembre, ce fut le tour de nos camarades les carabins de Besançon, Jacqueline
Marti et Juif. Ils passèrent deux jours avec nous, ce qui nous amena à
organiser la maison de ma grand-tante en véritable auberge de jeunesse. Il
fallait en effet réserver une chambre à la jeune personne de Montbéliard, très
"bon chic bon genre", ce qui nous obligeait, nous les garçons, à nous
empiler à quatre ou cinq dans l'autre turne.
Le résultat fut une épique bataille de polochons digne des meilleurs potaches.
Et pour corser la chose, il nous vint l'idée géniale de ne pas laisser notre
voisine en dehors de ces innocentes saturnales. Nous nous déguisâmes en
fantômes avec des draps de lit et des chaînes pour faire peur à la pauvre
Jacqueline. Je ne sais plus comment elle réagit à cette farce qui n'était pas
particulièrement raffinée…
D'autres visites féminines eurent
lieu à cette époque. D'abord celle de la sœur de François Jamey, qui répondait
au surnom de Totote et qui figure sur plusieurs photos de groupes. De
son côté, Jean Beugnot reçut la visite de sa tante Madame Régent et de sa
cousine Paulette. Ces deux dames résolurent le problème du logement en
séjournant chez une voisine.
Toutes ces visites étaient les
bienvenues car elles divertissaient un peu les réfractaires et leur apportaient
quelques nouvelles de l'extérieur. L'une d'elles, pourtant, fut d'une autre
nature, et totalement inattendue. Un soir, un homme habitant un hameau voisin,
le Grand Fahys, vint proposer à François Jamey et Lucien Pichery de participer
au groupe de résistance qu'il dirigeait. J'étais alors à Fougerolles. Je ne fus
donc pas témoin de la scène. Je crois qu'ils donnèrent leur accord de principe.
Le visiteur leur dit qu'il reviendrait les voir. Le 18 décembre, il était
arrêté avec son fils et plusieurs membres de son groupe. La plupart furent
fusillés au Sabot de Frotey le 16 février 1944. Le chef, Charles Barthélémy,
est mort en déportation. Il était distillateur au Grand Fahys et associé de
Joseph Larrière, le mari de Mélanie, voisine et amie de ma grand-mère. Mis à
part de rares rescapés des camps de concentration, le seul résistant
fougerollais qui ait réussi à passer entre les mailles du filet fut le
garagiste René Devoille, que j'ai bien connu. Le 29 novembre 1943 au soir, il
tira des coups de revolver sur les agents du Sicherheitsdienst de Nancy
qui venaient l'arrêter, sauta par la fenêtre et disparut jusqu'à la Libération.
Toutes ces dramatiques nouvelles
étaient évidemment au centre des conversations, de même que les informations
qui nous parvenaient par les ondes. Le 10 juillet, les Alliés débarquaient en
Sicile, le 25 le gouvernement fasciste s'écroulait, le 3 septembre le maréchal Badoglio,
chef du nouveau gouvernement, signait un armistice avec les Alliés. À l'Est,
l'Armée Rouge avançait de juillet à novembre, tandis que les villes allemandes
subissaient des attaques aériennes incessantes.
Toutes ces nouvelles contribuaient à
entretenir le moral. Par ailleurs, nous ne restions pas inactifs. J'aidais mon
oncle à la scierie, je bricolais dans l'atelier de menuiserie, je rendais
service à mes tantes qui étaient contentes de m'avoir chez elles comme jadis.
Pendant ce temps, mes camarades travaillaient chez Vicate et Hermine, à
la fenaison, à la moisson, à la cueillette des cerises, à l'arrachage des
pommes de terre. Ils devaient aussi couper du bois pour se chauffer et faire la
cuisine.

François s'était imposé dans la
fonction de cuisinier et parvenait tant bien que mal à nourrir son monde avec
les moyens du bord. À l'époque, les paysans des sections de Fougerolles et de
la région vivaient, quasiment en autarcie, de ce qu'ils produisaient. Et cela
était encore plus avéré en ces temps de restrictions. Une nourriture simple et
frugale était donc de mise. Il était aisé de se procurer sur place du lait, des
pommes de terre, du pain cuit à la ferme, du fromage du genre
"géromé", sorte de munster vosgien. Sans compter les tartes cuites en
même temps que le pain. Cette alimentation sobre et naturelle, je la
connaissais depuis toujours, étant né à Fougerolles et ayant fréquenté depuis
ma plus tendre enfance ma nombreuse parenté du coin. J'avais en mémoire les
visites que rendait ma mère, dans les années 1920, à ses tantes Marie et
Joséphine, la première habitant la maison de mon arrière-grand-père, la seconde
résidant dans la maison voisine, là où précisément étaient hébergés les
réfractaires.
Je me demande si cette vie simple,
dans un cadre agreste et rustique, cette existence qui paraissait être une
survivance des époques patriarcales, n'était pas aussi la préfiguration d'un
indispensable retour aux sources naturelles. Il y avait là une forme de
pérennité qui contrastait absolument avec l'instabilité générale du monde
actuel. Cependant nous ne nous posions pas de semblables questions. Notre
préoccupation était évidemment de survivre dans l'attente de jours meilleurs et
de tuer le temps afin d'éviter de tomber dans la mélancolie. Outre les travaux
agricoles et autres, nous avions à la belle saison la possibilité
d'entreprendre des randonnées dans cette région forestière et rustique à
souhait. J'allais de temps en temps voir mes grands-parents à La Vaivre, ou
quelque cousin dans son hameau isolé. Il arrivait aussi que mes camarades
descendent à Fougerolles pour un spectacle ou autre chose, mais la prudence
était de rigueur.
Il ne m'est arrivé qu'une fois de
quitter le périmètre fougerollais, et cela pour des raisons impératives.
J'avais un terrible mal de dents. La seule solution était d'aller chez un
dentiste, ma cousine Jeannine me conduisit à Luxeuil. Je dus attendre mon tour
au cabinet dentaire, en compagnie d'un soldat allemand qui avait d'autres chats
à fouetter que de courir après les réfractaires. Au retour, j'étais délivré de
ma molaire et de la peur d'un contrôle d'identité, mais je crachai du sang tout
le long du chemin, si bien qu'à l'entrée de Fougerolles j'abandonnai mon vélo
pour me reposer chez ma tante Marie-Louise, qui me prodigua quelques soins
urgents.
L'arrivée du mauvais temps nous
força, mes camarades et moi, à recourir à des distractions plus hivernales,
comme la lecture et le travail intellectuel. Lucien Pichery avait des concours
à préparer, François Jamey et moi des licences à terminer. Je recevais – par
l'intermédiaire de je ne sais plus qui – les cours de littérature d'Ayrault,
qu'il me fallait recopier page après page. Je possède encore un cours sur
Luther, en grande partie transcrit sous ma dictée par Lucien Pichery, qui avait
une très belle écriture. Nous travaillions souvent le soir, à la veillée, chez
Grigard ou chez le Moine, mais nous allions aussi passer les soirées chez des
voisins, en particulier au lieu-dit Chez le Cœur, où vivait un parent de
mes cousins, Georges Lemercier, ainsi que ses deux enfants. L'ambiance y était
toujours joviale, égayée notamment par l'ami François, ses chansons d'étudiant
et ses histoires drôles. Nous n'avions ni radio, ni télévision, mais un
phonographe et des disques de danses des années 30, ainsi que des
enregistrements du chansonnier nancéien Georges Chepfer, qui racontait des
histoires avec l'accent lorrain ou alsacien.
Ainsi passèrent six mois dont je
conserve un souvenir assez précis et plusieurs photographies que je ne revois
jamais sans une certaine émotion, car la plupart des personnes qui y figurent
ne sont plus de ce monde : Victor et Hermine, Juliette l'autre cousine germaine
de ma mère, Charles et Jeanne mes petits-cousins, l'autre Jeanne l'épouse de
René, ma cousine Jeannine Leyval, François Jamey et sa sœur, Claude Hasselot et
Pierre Jeannin…

Dans les derniers jours de l'année
1943, François se hasarda à retourner clandestinement à Scey-sur-Saône.
Personnellement, je ne me rappelle plus si je suis retourné chez mes parents,
mais je me souviens bien des magnifiques champs de neige du Sarcenot, au soleil
du mois de janvier, avec le regret que le ski de fond n'ait pas encore été en
vogue.
La situation stratégique du Reich
empira sans cesse début
Dans notre région, les condamnations
à mort et les exécutions se multiplièrent. À Besançon, Henri Fertet, élève du
Lycée Victor Hugo âgé de 16 ans, fut passé par les armes avec ses camarades le
26 septembre 1943. Cette exécution fit grand bruit dans la région, d'autant
plus que mes deux camarades Jean Rance et Marcel Dufils étaient avec lui à la
prison de la Butte et qu'ils se parlaient de cellule à cellule. Marcel Dufils
ne manquait pas d'aller voir les parents Fertet après la guerre, lorsqu'il
revenait dans la région. Le 16 février 1944, ce fut le tour du groupe
Barthélémy, comme je l'ai déjà indiqué, et le 6 avril mon camarade de lycée
Jean-Marie Monasson fut exécuté avec les résistants de Corre au Sabot de
Frotey. Vers la même époque, Robert Chaudey, qui jouait au football avec nous
au Sporting Club Frotéen, tomba sous les balles du peloton d'exécution à
la citadelle de Besançon.
Il était d'autant plus méritoire de
prendre l'initiative d'actes de résistance extrêmement périlleux. Ce fut le cas
de la famille Courrier, de Quincey, qui habitait une ferme isolée près du
Frais-Puits et qui cacha pendant plusieurs jours un parachutiste canadien avant
de le mettre sur le chemin de la Suisse. En 1952, Jim Macdonald, venu à Paris
pour visiter une exposition de peinture, fit un détour par Quincey pour saluer
Gilbert et Lucette Courrier.
Au début de 1944, je regagnai Quincey
grâce au répit intervenu dans la chasse aux réfractaires. J'avais obtenu du
maire Charles Chevillard une carte de travail et j'étais employé à la scierie
située au bas du village, le long de la rivière. En fait, cette occupation me
permettait surtout de sortir de la clandestinité et de pouvoir passer les
examens qui m'avaient été interdits en octobre 1943. Le 25 mai, je fus reçu
avec mention à mon dernier certificat de licence, celui de littérature.
En ce mois de mai, la situation était
extrêmement tendue. Tous les pays occupés de l'ouest européen attendaient le
débarquement des troupes alliées. La répression s'accentuait. Le 10 mai, mon
camarade de lycée Édouard Almand était arrêté à Dijon par la Gestapo, jeté dans
un cachot puis déporté en août à Buchenwald, entraînant la déportation de sa
sœur. Édouard, ancien saint-cyrien, travaillait avec un autre de mes anciens
condisciples, Pierre Rimey, pour les services de renseignements anglais.
Quelques jours avant, le 6 mai, était
survenue à Vesoul l'affaire Lecorney. Stéphane Lecorney était aussi l'un de nos
anciens condisciples. Reçu à Saint-Cyr avant la suppression de l'Armée de l'Armistice, il était devenu
répétiteur au Lycée Gérome et suivait les cours d'allemand avec moi en 1943 à
la faculté de Besançon. En fait, c'était une couverture pour ses activités de
résistant au sein du réseau Béarn. Le 6 mai, il échappa de justesse à un
agent de la police secrète devant la gare de Vesoul et se cacha sur le plateau
de Cita, d'où il gagna Dijon et Paris. Furieux, les Allemands déportèrent le 17
mai le préfet Théry, qui n'envoyait pas assez de travailleurs au STO, le chef
de bureau Filleul, qui délivrait les faux papiers, et l'ancien maire Hologne,
inscrit sur la liste des otages. Aucun des trois n'est revenu des camps.
Ces événements eurent d'immenses
répercussions à Vesoul et dans la région, qui eut la réputation d'être un
"repaire de terroristes". Ils eurent même une certaine incidence sur
mon propre sort, comme je vais le montrer ultérieurement.
Le débarquement de Normandie, le 6
juin, fut un second choc. Je l'appris vers 7 heures du matin par la radio suisse,
alors que je me préparais à aller à la scierie. Peu après, la BBC confirma la
nouvelle, qui était attendue, car quelques jours avant, Londres avait demandé
aux populations côtières de se retirer à dix kilomètres à l'intérieur des
terres. L'annonce du débarquement suscita bien entendu un immense espoir. Même
les sceptiques, qui doutaient des promesses des Anglo-Saxons, durent
s'incliner. C'est quelques jours plus tard que je rencontrai chez Paul Clavier
M. Richter, l'interprète de la préfecture. C'était un Lorrain dont la
belle-famille habitait du côté de Vallerois-le-Bois. Apprenant que j'étais
depuis peu licencié d'allemand, il me proposa de venir travailler avec lui. Il
était, me dit-il, submergé d'obligations depuis l'affaire Lecorney, les
services préfectoraux étant considérés comme suspects par la puissance
occupante. Lui-même, Richter, avait été interrogé à Besançon par la police
secrète. Sa proposition n'était donc pas un cadeau. Je lui demandai quelques
jours de réflexion, sachant que j'avais le choix entre l'acceptation et un
ordre de réquisition. Après en avoir discuté avec mes parents, je me décidai
pour l'acceptation.
Je pris mon poste le 19 juin. Le 21,
le Secrétaire Général Étellin, responsable en l'absence du préfet, signa un
arrêté me nommant interprète "à titre précaire et révocable". Je
faisais en réalité un travail de traduction des documents émanant de la Kommandantur
et d'autres services. La paperasserie que je devais traduire concernait
essentiellement les réquisitions de produits alimentaires ou autres, Richter
étant spécialisé dans les négociations avec les Allemands, qui venaient à tout
bout de champ commander ou se plaindre. Je prenais mon repas de midi dans une
pension de famille de la rue du Breuil. La patronne, une Alsacienne, nous
donnait les dernières nouvelles du front de Normandie. À cette époque, le
gouvernement de Vichy était en pleine déliquescence, les structures nationales
s'effondraient et chaque région s'efforçait de survivre tant bien que mal, dans
l'attente de la libération.
La grande nouvelle du mois de juillet
fut l'attentat contre Hitler, qui fut suivi, à Vesoul, du suicide d'un officier
allemand nommé von Richthofen. Il est probable que cet officier ait été
apparenté aux deux frères Richthofen, as de l'aviation de chasse pendant la
Première Guerre mondiale et descendant d'une vieille famille aristocratique
silésienne. Une autre question se pose : pourquoi s'est-il suicidé juste après
l'attentat du 20 juillet ? N'était-il pas compromis dans le complot tramé
contre Hitler par la caste militaire ? N'oublions pas que les conjurés
n'étaient pas qu'à Berlin, mais aussi à Vienne, à Prague et à Paris, où ils
emprisonnèrent pendant une journée les SS et la Gestapo, avant d'apprendre
l'échec de l'attentat.
Le 15 août 1944 allait me donner
l'occasion inattendue d'approcher un authentique représentant de cette caste.
Le matin avait eu lieu en Provence le second débarquement, forçant les troupes
allemandes du Midi à refluer vers le Nord. C'était l'Assomption, donc jour
férié. J'étais avec mes parents lorsqu'au début de l'après-midi mon collègue
Georges Saguin vint m'annoncer que le Secrétaire Général Étellin voulait me
voir d'urgence. Le chef de la Feldkommandantur réclamait à cor et à cri un
interprète pour lui communiquer un ordre important. Richter étant absent, il
m'incombait de le remplacer. Malgré l'opposition de ma mère, qui me voyait déjà
pris comme otage, je montai sur la moto de Saguin, qui me conduisit à l'Hôtel
de Ville de Vesoul, me souhaita bon courage et m'assura que si je ne
réapparaissais pas, il préviendrait mes parents. Il faut avouer que je n'étais
guère rassuré. Un soldat me conduisit au premier étage, dans un vaste bureau
qu'ornait, si ma mémoire est bonne, un portrait d'Hitler. Je me trouvai en face
d'un officier supérieur, qui me fit asseoir avant de me tenir un bref discours
que je résumerai ainsi : un second débarquement vient d'avoir lieu, la
situation est de plus en plus tendue, les troupes allemandes sont l'objet
d'attaques fréquentes, désormais aucun véhicule civil n'aura le droit de
circuler sur les routes du département, sauf les ambulances et les pompiers.
Cette interdiction sera notifiée par des affiches à placarder dans toutes les
communes. Je devais en informer immédiatement le Secrétaire Général.
Cet officier était le Colonel von
Maltzahn. Je sus plus tard qu'il appartenait à une famille aristocratique qui
avait donné à la Prusse plusieurs généraux et hommes d'État. Mais sur le moment
je ne m'en souciais guère. J'étais si troublé que je faillis faire une bévue
dans mon compte rendu à Étellin. Celui-ci me fit fort justement remarquer que
le colonel n'avait certainement pas dit que les véhicules qui rouleraient sans
autorisation essuieraient le feu des patrouilles allemandes, mais qu'ils
risqueraient de s'y exposer. Il valait mieux, ajouta le Secrétaire Général,
éviter un incident diplomatique dans des circonstances aussi graves. Plus tard,
j'ai parfois raconté cette histoire à mes étudiants pour leur faire comprendre
la nécessité d'une traduction précise.
Les événements se précipitaient. Dans
la matinée du lundi 21 août, le Secrétaire Général informa le personnel de la
préfecture que de hautes personnalités devaient s'y arrêter au cours de
l'après-midi et que tous les employés devaient rester consignés dans leurs
bureaux, portes, fenêtres et volets clos. Ces mesures draconiennes ne nous
empêchèrent pas de voir une grande limousine noire pénétrer dans la cour, un
homme âgé en descendre et entrer dans le bâtiment. Nous reconnûmes aussitôt le
Maréchal Pétain. L'un de nos collègues réussit à prendre plusieurs
photographies absolument inédites, le transfert de Pétain de Vichy à Belfort
devant se dérouler incognito, ce qui n'empêcha pas quelques jeunes pétainistes
de distribuer des exemplaires de la protestation rédigée par le Maréchal avant
son départ de Vichy.
Nous fûmes ainsi témoins du
"rapt" de Pétain, qui devait théoriquement former un autre
gouvernement à Belfort mais qui dut, début septembre, continuer son voyage
forcé jusqu'à Sigmaringen. Je n'insisterai pas ici sur cet épisode historique,
auquel j'ai déjà consacré une interview pour le 50ème anniversaire
de la libération de Vesoul (cf L'Est Républicain du 18-9-1994) et un
article dans le bulletin de la Société d'Agriculture, Lettres, Sciences et
Arts de la Haute-Saône (n° 27, 1995).
Le départ du Maréchal était le signe
tangible de l'effondrement du régime de Vichy. La Trouée de Belfort étant la
porte d'entrée de l'Allemagne du Sud, nous eûmes le privilège de voir passer
chez nous bon nombre des 4000 membres de la Milice de Darnand réfugiés en
Allemagne. Ces individus de sac et de corde, qui avaient la gâchette facile,
sévirent plusieurs jours à Vesoul et assassinèrent en particulier le patron du
Café de l'Union, père de notre camarade de lycée Robert Marguerite.
Dans ce chaos, nous apprenions la
libération de Paris le 25 août, et le 27 une nouvelle sensationnelle : une
unité de 820 Ukrainiens, amenés de Prusse Orientale pour lutter contre les
maquis, massacra tout son encadrement SS et passa avec armes et bagages du côté
des FFI. Elle était désormais commandée par un certain Simon Doillon, qui sera
tué un mois après dans les Vosges. Son frère Jean, pilote de chasse, trouvera
la mort lui aussi le 24 décembre dans la Forêt-Noire. Tous deux étaient les
fils de la comtesse de Montjustin, Simone de Vaulchier, que nous connaissions,
mes parents et moi, depuis l'époque d'Arpenans.
Début septembre, la retraite des
troupes allemandes prit des proportions qui rappelaient l'exode de 1940. Le
déferlement continu des unités du Sud et du Sud-Ouest, menacées d'être prises
en tenaille entre les armées alliées venant de l'Atlantique et de la
Méditerranée, remontait par vagues successives vers la Trouée de Belfort. Des
véhicules hétéroclites, camions surchargés, voitures sans portières,
motocyclettes et bicyclettes en plus ou moins bon état formaient un défilé
incessant que nous allions regarder à la jumelle du haut des collines. Chaque
jour, des éléments de cette procession envahissaient le village pour y chercher
un peu de repos et de ravitaillement. Quand deux ou trois unités surgissaient
coup sur coup, le maire et le secrétaire de mairie devaient résoudre la
quadrature du cercle.
Au cours de ces journées harassantes,
les incidents se succédaient. Ne les ayant plus tous en mémoire, je n'en
rapporterai que trois ou quatre.
Un soir, un officier fit irruption
avec ses hommes et demanda un cantonnement pour la nuit. Le maire et mon père
finirent par régler la question et la soirée se prolongea, je ne sais pourquoi,
chez Georges Nicot. Elle fut bien arrosée et l'officier n'avait pas l'air
pressé d'aller dormir. Il était instituteur dans le civil et avait un peu
appris le français. À une heure plutôt tardive, il se décida à revenir à
l'école, où il devait occuper la dernière chambre de notre appartement. Il
ordonna à une sentinelle d'obéir à ses consignes si un incident survenait au
cours de la nuit. Visiblement, il n'avait pas confiance, et quand il finit par
gagner sa chambre, il posa ostensiblement son revolver sur la table de nuit… Je
cachai, à tout hasard, un coup de poing américain sous mon oreiller. Le
lendemain aux aurores, le bonhomme disparut sans tambour ni trompette.
Un autre soir, mon voisin Charles
Cornu me demanda de venir d'urgence dans la grange de ses parents, tout un
groupe de Boches l'ayant envahie. Je
constatai bientôt que ces Boches
n'étaient pas des Allemands, en dépit de leurs uniformes vert-de-gris. Ils
étaient une douzaine, conduits par un chef qui se disait Polonais et qui
parlait bien la langue de l'occupant. J'appris par lui que ces hommes
originaires d'URSS avaient été déportés vers le Mur de l'Atlantique, qu'ils
avaient déserté à la faveur d'un bombardement et avaient marché vers l'Est des
jours durant. Ils mouraient de faim et avaient un aspect pitoyable. Plusieurs
voisins leur apportèrent à manger et ils passèrent la nuit dans la grange.
Le lendemain matin, leur chef reprit
la route, juché sur un vélo sans pneus et poussant devant lui son misérable
troupeau. Coup de théâtre un peu plus tard : la troupe revenait sans le chef !
L'un de ces malheureux m'expliqua dans un allemand approximatif que le Polaque était tombé de son vélo et que
toute la bande en avait profité pour se sauver. Mais pour nous, à Quincey, le
problème n'était pas simple. Où loger, où cacher cette cohorte de déserteurs
dans un village déjà occupé par une unité de la Wehrmacht ? Mon père décida de
les installer dans les salles de classe au rez-de-chaussée, bien que nous
logions quatre soldats au premier étage. Cette situation ne pouvait durer. Deux
jours après, nous conduisîmes ces pauvres hères au moulin de Champdamoy, en
attendant l'arrivée des Américains. En parlant avec celui qui comprenait un peu
l'allemand, j'avais appris qu'ils avaient été prisonniers en Allemagne,
condamnés à mourir de faim ou à travailler pour le Grand Reich. Ils portaient
sur leur manche un écusson avec deux cimeterres croisés et une flèche, ainsi
que l'inscription Idel-Ural.
J'ai su plus tard qu'ils venaient de
la République autonome des Tatars de la Volga. Le jour de la libération, je
signalai leur présence à un officier américain. Je ne sais comment les
libérateurs les ont traités, mais je doute fort que les soldats du Texas ou du
Kansas aient saisi la différence entre les Allemands et ces malheureuses
victimes. Qui plus est, s'ils ont été renvoyés en URSS, ils ont à coup sûr pris
aussitôt le chemin du goulag.
Il m'est impossible de rapporter tous
les incidents mineurs qui sont survenus au cours de ces journées critiques.
L'affaire la plus dramatique eut lieu vers le 8 septembre, à quelques
kilomètres de Quincey, lorsque les maquisards d'Esprels tuèrent sept soldats
allemands qui prenaient leur repas de midi au café des Belles Baraques. Les
morts, enterrés en hâte à Vallerois-le-Bois, furent retrouvés par les Allemands
qui prirent des sanctions.
Ce drame et quelques autres actions
des maquis du coin déclenchèrent la réaction des occupants. Les quatre qui
logeaient à l'école dévalèrent l'escalier en criant « Terroristen » et ils sautèrent dans leur voiture, les
armes à la main. Peu après, le maire arriva pour parler de la situation avec
mon père. Il était complètement affolé, surtout quand mon père lui annonça
qu'il avait caché son fusil derrière les registres d'état civil de la mairie…
Entre temps les Allemands, qui
voyaient des terroristes partout, tiraient à tort et à travers le long de la
route de Villersexel. Ils avaient blessé Jean Mantion, un cultivateur dont le
fils Paul gardait ses vaches dans les prés. Ils l'avaient amené près de la
mairie de Quincey, ainsi que deux autres hommes du village, M. Boissenet le
cantonnier et M. Monange. La situation était angoissante. Les trois otages
attendaient près de la croix de pierre que leur sort soit réglé. Des Allemands
morts et blessés gisaient près de la croix.
Le désastre fut finalement évité
grâce à l'intervention du maire, de mon père et de Constant Chevillard, qui
était comme moi étudiant à Besançon et qui obtint que Jean Mantion soit pansé
par un médecin militaire allemand avant d'être transporté à l'hôpital de Vesoul.
Finalement le chef de l'unité imposa à la commune la fourniture d'œufs et de
haricots pour le ravitaillement de ses hommes. Quincey l'avait échappé belle !
Nous approchions du 12 septembre, et
la 7ème Armée américaine, venant de Besançon, approchait de Vesoul.
La Wehrmacht avait chargé un régiment de grenadiers de défendre la ville, afin
de permettre aux derniers fuyards de s'échapper. Vesoul vivait au ralenti. Les
administrations étaient paralysées. Nous logions dans la maison de l'impasse
une famille vésulienne de quatre personnes et un gendarme en civil. Nous
attendions anxieusement les événements. Mes parents défendaient tant bien que
mal leurs poules et leurs lapins contre les chapardeurs en uniformes qui, faute
d'intendance organisée, cherchaient à se nourrir sur le dos de la population.
Vieille tradition des guerres de jadis !
Je parlais de temps en temps avec
l'un ou l'autre de ces soldats en retraite pour essayer de jauger leur moral.
Certains avaient combattu en Normandie et reculaient depuis des mois.
Croyaient-ils encore à la victoire finale ? Je n'en suis pas sûr. L'un d'eux me
dit qu'ils évacuaient le pays, mais qu'ils reviendraient. Je pris cette
affirmation pour l'expression d'une sorte de morgue ou d'arrogance. En fait, le
plan du haut commandement allemand consistait à reculer jusqu'aux Vosges afin
de stabiliser le front et de lancer ensuite une contre-offensive. Les armes
secrètes devaient jouer là un rôle capital. La propagande essayait ainsi de
remonter le moral des troupes.
Le 11 septembre, les Américains
libéraient Noidans et Échenoz-la-Méline. Le
Il est environ 16 heures. Les
responsables FFI battent le rappel afin que nous descendions à Vesoul, où le
combat a cessé au centre de la ville.
Nous voilà mobilisés avec plusieurs
jours de retard, car nous aurions dû rejoindre le groupe de Noidans le 7 ou le
8 septembre. Il devait y avoir un grand rassemblement aux Quatre Sapins,
au-dessus de Navenne, mais personne ne nous a fait signe. Dans le chaos
général, ce n'est pas étonnant.
Chargés de notre armement de fortune,
nous marchons en colonne vers la Place de la République, où sont rassemblés
tous les FFI du voisinage. Mon père est là aussi, de même que Joseph Cote, le
père de mon ami Pierre. Les responsables nous passent en revue et nous
attribuent des missions.
Je suis désigné pour garder le Restaurant
des Deux Gares pendant la nuit, afin d'éviter le pillage. Je passe la nuit
couché par terre au milieu des vitres cassées, en compagnie d'un Canadien
engagé dans l'armée américaine. Par la suite, on décide d'utiliser mes
compétences : je suis chargé de récupérer les livrets militaires sur les
cadavres allemands. J'en trouve un certain nombre sur les pentes où les obus
américains ont fait mouche.
Nous allons aussi enlever deux corps
de Français inconnus, tués par les occupants dans le secteur du Frais-Puits.
Tâche rebutante s'il en est !
Plus tard encore, on a recours à mes
compétences de chauffeur. Au volant d'une Simca sans portières, je parcours la
région pour ramener à la caserne le matériel abandonné. Avec une vieille
camionnette aux freins usés, je vais chercher de la farine au moulin de
Vellefaux. Une fois, rentrant au quartier Luxembourg, je vois venir à moi une
femme accablée. Elle est tondue et retenue prisonnière. Elle me dit qu'elle est
en danger de mort et me prie de prévenir sa mère. C'est une collègue de mes
parents, qui enseigne dans la banlieue de Vesoul. À Quincey, ces jours-là, une
ou deux femmes sont aussi victimes de la vindicte publique. Rien n'est plus
terrible qu'une foule déchaînée.
Les Américains étaient là, mâchant du
chewing-gum et fumant des Lucky Strike. Ils déambulaient en groupes sur les
trottoirs, passaient en trombe sur des motos pétaradantes, submergeaient les
routes de véhicules blindés, de GMC, de Dodges et de jeeps. Après le lamentable
spectacle de la débâcle nazie, cette irruption d'une puissance mécanique
formidablement organisée m'apparaissait à la fois comme secourable et
inquiétante.
Les Allemands n'avaient pas tous
disparu. Quelques égarés essayaient de sauver leur peau. René Figard,
cultivateur aux fermes de Quincey, demanda aux FFI de venir faire une battue
autour de chez lui. Un soldat allemand avait pénétré dans sa ferme isolée pour
exiger de la nourriture. Pendant qu'il mangeait, René lui avait subtilisé son
fusil. L'Allemand s'était sauvé, échappant de justesse aux coups de feu tirés
sur lui. Nous partîmes donc un soir à quatre ou cinq, sans trouver trace de
notre homme. Il se rendit, je crois, peu après aux autorités françaises.
Un autre jour, quelqu'un aperçut un
soldat allemand traversant les prés à l'emplacement de l'actuel Lotissement du
Bas des Vignes. Un groupe de quatre ou cinq jeunes, dont j'étais, courut dans
cette direction, poursuivit le fugitif, qui avait pris ses jambes à son cou,
jusqu'au bord de la rivière. Pris de panique, apeuré par les coups de pistolet
que l'un d'entre nous tirait en l'air, notre homme abandonna la partie. Ramené
au village, il fut interrogé et j'appris ainsi qu'il s'était évadé d'un camp de
prisonniers. C'était un jeune garçon qui avait été incorporé de force dans une
unité de SS, comme cela arrivait de plus en plus à la fin de la guerre.
Toutes les armes récupérées n'étaient
pas déposées au quartier Luxembourg. Certains récupérateurs en gardaient pour
se constituer des collections et pour faire des séances de tir. À Quincey, nous
tirions au fusil de guerre et même au fusil-mitrailleur dans une combe située
le long de la route de Villersexel. Dans le Petit Bois, près du Chemin de la
Craie, nous tirions à la mitraillette Sten, une arme très rustique que les
Anglais parachutaient pour les maquis. Nous tirions des balles de
pistolet-mitrailleur allemand de calibre 8, que j'avais récupérées en grande
quantité et qui fonctionnaient correctement tant que l'engin ne s'enrayait pas.
Mais un beau jour la police militaire
eut vent de nos exercices de tir. Deux policiers, dont le futur champion de
moto Jacques Collot (ses parents avaient un garage au Boulevard) vinrent
prendre possession des armes. Je leur donnai deux fusils et je gardai le reste,
y compris la mitraillette Sten. Tout cela fut distribué par la suite à ceux qui
en voulaient, surtout à mes cousins. La loi ayant été rétablie peu à peu et la
possession d'armes de guerre interdite, nous n'avions plus qu'à nous rabattre
sur les armes de chasse. Ce que je fis avec quelques copains. C'est alors que
je tuai mon premier – et dernier – lièvre.
Cependant les administrations, y compris
la préfecture, avaient recommencé le travail. Je repris donc le chemin du
bureau, où je fus chargé d'organiser l'utilisation des prisonniers allemands.
La tâche n'était pas trop compliquée. Elle l'était par contre beaucoup plus
quand il fallait parlementer avec nos visiteurs américains, dont le langage et
l'accent n'avaient rien de commun avec l'anglais scolaire et rudimentaire que
j'avais appris. De toute façon, le contrat que j'avais signé en juin avec la
préfecture se terminait le 30 septembre. À partir du 1er octobre,
j'étais donc libre comme l'air.