Chapitre 12
Les années d'illusion, 1937-1939
Scolairement parlant, l'année 1936-1937 fut pour moi
très satisfaisante. Ce fut peut-être la meilleure de toute ma scolarité. Je fus
le seul, avec Caquot et Vuillemin, à être félicité chaque trimestre. Même en
mathématiques et en sciences naturelles, mes appréciations étaient correctes. À
la distribution des prix, le 13 juillet 1937, j'obtins celui de l'Association
Amicale des Professeurs du Lycée Gérome, prix spécial
« destiné à récompenser un élève qui
s'est particulièrement distingué par son travail et sa conduite ».
Cette distinction était certes moins
prestigieuse que les prix d'honneur attribués à nos camarades plus âgés Lucien
Dondaine, plus tard agrégé des lettres, Jean Poirson,
qui fit une brillante carrière chez Solvay, ou Annie Almand,
sœur de notre ami Édouard Almand, tragiquement
disparue en 1945. Mais cette récompense avait de quoi satisfaire mes parents et
m'encourager pour la suite.
Pourtant l'année 1937 reste dans les
annales pour une raison bien différente : j'ai fait alors mon premier séjour en
Allemagne. Envoyer les enfants à l'étranger est aujourd'hui une affaire de
routine. Tel n'était pas le cas à l'époque. De plus, aller en vacances en
Allemagne hitlérienne tenait quelque peu de la gageure.
Il faut ajouter qu'au lendemain des
Jeux Olympiques de Berlin, en 1936, le Troisième Reich poursuivait ses efforts
de propagande en direction de l'étranger, afin de donner le change quant à sa
véritable nature. L'offensive de paix visait en particulier la France, dont il
convenait de tromper la vigilance en s'adressant à certains milieux sensibles
tels les anciens combattants, les pacifistes, les jeunes. Les illusionnistes du
Dr Goebbels étaient des manipulateurs redoutables, qui bernaient non seulement
les Français, mais aussi bon nombre de leurs compatriotes. C'est ainsi qu'à
l'été 1937 un train entier d'anciens combattants franc-comtois fut reçu en
grande pompe à Fribourg-en-Brisgau et qu'un
autre train, badois celui-là, fut accueilli à Besançon. Il y a fort à
parier que parmi ces anciens soldats allemands, beaucoup n'étaient pas de
fervents partisans du régime.
L'imposture régnait, et il n'est pas
fortuit que le célèbre film de Jean Renoir La grande illusion soit sorti
précisément en
J'ajoute qu'une vieille tradition,
datant d'avant 1900, unissait le Lycée Gérome à la
ville de Fribourg-en-Brisgau. J'ai consacré un article intitulé Vacances
badoises à la belle époque aux deux voyages entrepris au-delà du Rhin, en
1892 et 1899, par des élèves vésuliens accompagnés de leur professeur
d'allemand Maigniez. Cet article est paru au début
des années 1980 dans le bulletin de l'Association Amicale des Anciens Élèves du
Collège et du Lycée Gérome.
Plus tard, en 1997, plusieurs
camarades et moi avons organisé une table ronde à la SALSA (Société
d'Agriculture, Lettres, Sciences et Arts) de la Haute-Saône sur le thème Vacances
studieuses chez l'"ennemi héréditaire". Ce fut l'occasion pour
nous de raconter nos vieux souvenirs de 1937-1938, souvenirs aussi lointains
qu'émouvants.
1937 fut donc, au point de vue des
relations franco-allemandes, une année faste, une année de pause dans la
stratégie hitlérienne, qui consistait alors à anesthésier l'opinion et à
camoufler les véritables intentions du Troisième Reich.
Haug m'avait choisi comme famille
d'accueil celle d'un garçon de mon âge, prénommé Helmuth,
qui allait au Friedrichgymnasium de Fribourg. Dans
une lettre du 26 mars 1937, il se présentait à moi : il était le troisième
enfant d'une famille de sept, son père était fonctionnaire au consulat allemand
de Zurich, lui-même était né à Stockholm et ils avaient vécu cinq ans en
Amérique avant de revenir en 1933 en Allemagne. Il ajoutait qu'il ne pouvait
pas écrire en français, étant donné qu'il ne l'étudiait que depuis un an. Après
ces généralités, il m'écrivit un mois plus tard pour m'expliquer ce qui, selon
toute apparence, était au centre de ses préoccupations : la Jeunesse hitlérienne.
J'appris ainsi que Helmuth était chef d'une Jungenschaft (groupe de 10 membres) du Jungvolk, c'est-à-dire des éléments les plus jeunes
de la Hitlerjugend. Il était en outre
suppléant du chef de section (Zug) et était de
service le mercredi et le samedi. Son unité partait du samedi après-midi au
dimanche soir dans un chalet de montagne où il se proposait de m'emmener quand
je serais chez lui… à condition que je lui indique assez tôt la date de mon
séjour, car il devait faire une randonnée du côté de Berchtesgaden.
Cette lettre m'apprenait déjà
beaucoup sur les centres d'intérêt de mon futur correspondant, notamment sur
l'un des principes de base du système national-socialiste, le Führerprinzip, qui était appliqué dès le plus jeune
âge.
Une lettre du 11 juin, écrite par
Madame Kulke, sa mère, m'invitait aimablement chez
elle. Elle avait vécu en France avant 1914 et souhaitait que ses enfants
apprennent à connaître notre pays comme j'allais connaître et comprendre
l'Allemagne.
Je partis pour Fribourg quelques
jours après le 14 juillet, en compagnie de ma mère qui ne voulait pas me
laisser faire seul un voyage à l'étranger dans des circonstances aussi
risquées. Nous déjeunâmes au buffet de la gare de Colmar et je poursuivis
l'aventure dans le train de Colmar à Fribourg, sans ma mère, mais avec une
famille alsacienne qui, au terminus, m'aida à trouver mes hôtes. En vérité, ils
ne pouvaient passer inaperçus, car ils s'étaient déplacés en nombre. Ils
m'invitèrent d'abord au buffet de la gare afin de faire plus ample
connaissance. Madame Kulke déclara que je n'étais
nullement un « ennemi héréditaire », mais déjà un ami. Le fils aîné,
Wolfgang, remarqua que je portais le « typique
béret français », le béret basque. Après quoi tout le monde prit le
tramway pour aller vers la Karthäuserstrasse (Rue des
Chartreux) où se trouvait la maison Kulke.
Cette maison était neuve, spacieuse
et située dans un agréable cadre de verdure. Un ruisseau bordé de prés coulait
le long de la route, et la forêt était juste derrière, permettant de faire de
jolies promenades. Cet environnement de verdure et de sapins avait un petit air
vosgien qui m'était familier. Je n'eus donc aucune peine à m'accoutumer à ce
milieu étranger, hormis les difficultés liées à la langue. Mais je pense avoir
fait, dans le domaine de la compréhension et du maniement de l'allemand parlé,
de rapides progrès, d'une part grâce à l'aide de Madame Kulke,
d'autre part grâce aux solides connaissances grammaticales, lexicales et
syntaxiques acquises au lycée.
Comme me l'avait écrit Madame Kulke avant mon arrivée, la famille vivait très simplement.
Avec sept enfants, une maison neuve, les charges étaient lourdes, sans compter
le poids énorme du réarmement de l'Allemagne, qui obérait l'économie nationale.
Comme de coutume, le confort domestique passait avant l'alimentation, d'autant
plus que les Kulke avaient vécu en Suède et aux États-Unis.
Je crois me souvenir que la nourriture quotidienne comprenait essentiellement
des légumes et des fruits du jardin, lequel était l'objet de tous les soins de
la part de Madame Kulke et de ses enfants. Avec Helmuth et son frère Richard, plus jeune que nous, je
mettais aussi la main à la pâte.
La situation générale et les
circonstances familiales convergeaient donc pour entretenir un mode de vie plus
ou moins autarcique dont le signe le plus tangible était la récupération des
déchets. À l'époque où les chimistes allemands s'employaient à fabriquer des Ersatz,
les ménagères mettaient soigneusement dans des sacs tout ce qui pouvait être
recyclé. Intrigué, je demandai à Mme Kulke quelle en
était la raison. Elle me répondit que l'Allemagne ne pouvait plus importer
certains produits parce qu'elle avait perdu ses colonies. Cette allusion aux
clauses du Traité de Versailles me parut une réponse pertinente.
La vie quotidienne à la Prairie
d'Odile (Ottilienwiese),
qui était le nom du lotissement où se trouvait la maison, me permit de faire
connaissance avec tous les membres de la famille Kulke.
Je n'ai rencontré M. Kulke père que rarement, le
dimanche lorsqu'il était rentré de Zurich, où il travaillait au consulat
allemand. C'était un homme sympathique et affable, qui avait l'avantage de
vivre à l'étranger et d'échapper ainsi à l'endoctrinement par la propagande
officielle. Il n'en était pas de même de son épouse, admiratrice du Führer et
catholique fervente qui, comme beaucoup d'Allemandes de l'époque, tenta
longtemps de concilier deux conceptions du monde diamétralement opposées.
Parmi les sept enfants, on comptait
quatre garçons et trois filles, Wolfgang, Helmuth,
Richard et Bernhard, Roswitha, Uta et Hadumoth. Seuls Wolfgang et Roswitha
étaient plus âgés que moi. Bernhard, le plus jeune de tous, a dix ans de moins
que moi. Je ne l'ai pas vu depuis bientôt 70 ans, et c'est malgré tout grâce à
lui que je suis toujours en contact avec sa famille.
Madame Kulke
accomplissait chaque jour la mission dont on l'avait chargée et qu'elle
assumait certainement de bonne foi : expliquer à son jeune invité français
l'Allemagne nazie. Elle profitait souvent d'une promenade dans la forêt proche
pour me parler des mérites d'Hitler, de l'éducation de la jeunesse et de
quelques autres sujets du même genre. De toute évidence, son hospitalité et sa
générosité étaient sincères, mais elle était d'une absolue crédulité en matière
politique. Sa maison était largement ouverte à tous. Lorsque j'y étais en
juillet et août 1937, il y avait là une parente de la famille et un étudiant
autrichien en stage dans l'agriculture (Landhilfe). J'ai compris plus tard qu'il s'agissait d'un
nazi autrichien venu préparer l'Anschluss de mars 1938. Il fut remplacé à la
mi-août par mon ami Jean Rance, au sujet duquel Mme Kulke
écrivit le 2 août à ma mère : « Jean
me dit qu'il est un bon et intelligent garçon, et je crois que Jean serait très
heureux de l'avoir ici. »
L'épistolière faisait aussi de grands
compliments de moi, ce qui fit certainement plaisir à maman. Je me contenterai
de souligner qu'elle notait une nette amélioration de la politesse générale
dans la maison depuis mon arrivée :
« Mes fils surtout remarquent, ajoutait-elle, que c'est étonnant comment les Français sont polis. Ça se voit qu'ils
ont été en Amérique, où on prend tout le monde en camarade, surtout les mères. »
Je me souviens qu'elle faisait
remarquer à ses garçons que je m'habillais toujours correctement pour les
repas. Et il est vrai que l'Allemagne hitlérienne, comme la Prusse de Frédéric
II toujours vêtue de bleu, avait une tendance fâcheuse à s'habiller de brun,
autrement dit à porter en toute occasion des uniformes militaires. Le peuple
allemand était devenu, pour user de la formule imaginée plus tard par l'un de
mes collègues, « la nation soldatique ».
Une photographie des enfants Kulke prise à cette époque est du reste caractéristique.
Elle les montre rangés selon la taille, du plus grand, Wolfgang, au plus petit,
Bernhard, tous en uniforme de l' Arbeitsdienst,
de la HJ, et pour les filles, du BDM (Bund Deutscher Mädel).
Peu après mon arrivée, un grand
gaillard botté, en uniforme de SA, vint m'inviter à une soirée folklorique
donnée par une troupe originaire du Banat, une région d'Europe centrale peuplée
d'Allemands depuis le 18ème siècle. Cette manifestation, assez
pittoresque, répondait à la politique nationale-socialiste de regroupement des Volksdeutsche (Allemands de souche) éparpillés à
travers l'Europe centrale et orientale.
En vérité, je me suis plus amusé ce
soir-là qu'au Friedrichgymnasium,
l'établissement fréquenté par Helmuth, où je me suis
plutôt ennuyé, mis à part le cours de français où le professeur me demanda de
parler de mon lycée et de Vesoul. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le fait que
les heures de classe commençaient et finissaient par le salut hitlérien. Cela
me rappela une histoire amusante : quelques années auparavant, deux petits
Italiens arrivant à Quincey sans savoir un traître
mot de français entrèrent dans la classe de mon père en faisant le salut
fasciste. Ils comprirent vite que ce n'était pas l'usage chez nous…
Mon correspondant m'avait promis de
m'emmener un week-end « auf die Hütte »,
c'est-à-dire au chalet de la Hitlerjugend où
son unité s'entraînait. Départ vers trois heures un samedi après-midi, avec des
provisions pour un jour et demi. Montée à vélo en direction du Feldberg, le
point culminant de la Forêt-Noire. Dépôt des vélos dans une ferme et montée à
pied jusqu'au chalet en question. Il y a dans le groupe un Français de Tunis
qui doit se sentir un peu perdu. Le confort est rudimentaire. Nous dormons sur
des châlits, du moins nous essayons de dormir, car soudain, en pleine nuit, le
chef de la bande réveille tout le monde à coups de sifflet stridents. Il s'agit
pour les Allemands de faire des exercices de nuit dans la montagne. Quant à
nous, le Tunisien et moi, nous nous rendormons.
Le lendemain matin, on hisse le
fanion à croix gammée au mât dressé devant le chalet. On chante, on salue le
bras levé. Puis les exercices reprennent, notamment le lancer de grenades à
manche auquel je suis invité à participer. Comme je suis entraîné au sport et
que je viens d'obtenir le premier prix d'éducation physique au Lycée Gérome, je me tire bien de cette épreuve. Ma cote est en
hausse et mon camarade Helmuth fera des compliments
de moi en rentrant à Fribourg. Par contre, mon compatriote tunisien est moins
bien traité. Des garnements l'ont attaché et assis dans un baquet devant le
chalet, je ne sais pour quelle raison.
Et les exercices paramilitaires
continuent. Il s'agit notamment de descendre un torrent, avec de l'eau jusqu'à
la ceinture, des rochers et des cascades. Même en plein été, l'eau est plutôt
fraîche. Mais il s'agit d'aguerrir la jeunesse en prévision du prochain
conflit, qui officiellement n'aura pas lieu…
Je suis invité un jour à visiter une
exposition sur la Wehrmacht. On y voit quantité de petits soldats de plomb en
uniforme vert-de-gris. Quant aux soldats ennemis, ils sont bleu horizon !
Paradoxe en cette période d'offensive de paix, mais je me garde d'approfondir
le problème. À nos âges, la grande politique est un domaine abscons. Ce qui
nous frappe, mes camarades et moi, c'est le côté impressionnant, insolite des
organisations de jeunesse, les manifestations et les défilés, les uniformes et
les drapeaux, en un mot la mise en scène de l'ordre et de la discipline dans
laquelle le nazisme était passé maître, le plus grand spectacle du genre étant
évidemment le congrès annuel du parti à Nuremberg. Il faut rappeler que
certains intellectuels français succombèrent à cette apothéose de la puissance.
Nous étions plus sensibles, nous les
jeunes, à l'aspect scoutisme de la Hitlerjugend, à la vie en commun dans la nature, aux feux de
camp, aux randonnées pédestres et au chant choral. Là encore, le
national-socialisme était très habile à exploiter pour ses objectifs politiques
les vieilles traditions romantiques allemandes. Pour nous, observateurs français,
il y avait là un côté ludique propre à plaire à la jeunesse et dont nous ne
percevions pas le danger. Notre amusement était de nous déguiser avec les
uniformes de nos camarades, comme le montrent des photos prises dans le jardin
de la maison Kulke. On m'y voit avec Jean Rance en
short, chemise brune, brassard à croix gammée, casquette ornée de l'aigle,
ceinturon et baudrier. Martial Depoulain, chez son
logeur, s'accoutrait de la même façon avec ses camarades.
Mon vieil ami Pierre Jeannin
m'écrivait des Alpes :
« Tu n'as encore pas vu Hitler ? J'espère bien que
malgré les saluts hitlériens qu'on a dû te faire faire, tu ne t'es pas encore
engagé dans les Sections d'Assaut. »
Et Pierre Vuillemin, dans une carte
postale de Toulon :
« Les copains Depoulain, Socrate
et Tintin doivent se plaire également là-bas, et j'espère que Socrate nous
reviendra ferré en allemand. »
Nous n'étions pas les seuls Français
à Fribourg, loin de là. En cet été 37, la Forêt-Noire était très fréquentée par
nos compatriotes. Parmi eux, du reste, on trouvait d'étranges touristes. Étant
allé un jour camper au Titisee avec Richard Kulke, je
constatai que nos voisins de camping étaient des fascistes français en
uniforme. Jamais je n'avais vu en France ce genre de personnages. J'ai
l'impression que toute l'Europe d'extrême-droite venait en stage dans le Reich
hitlérien.
À ce propos, je dois mentionner un
événement considérable auquel j'ai assisté alors : le Grosser
Bergpreis von Deutschland (Grand Prix de la Montagne), course
internationale d'automobiles qui avait lieu au Schauinsland
et à laquelle participaient des pilotes de plusieurs pays. Je me rappelle y
avoir vu notamment les deux vedettes allemandes Rudolf Caracciola
et Bernd Rosemeyer, qui devait se tuer six mois plus
tard sur l'autoroute Francfort-Darmstadt en tentant de battre un record de
vitesse. Une foule immense de spectateurs s'était réunie au Schauinsland,
y compris des ballilas, membres des jeunesses
mussoliniennes qui, en septembre, allaient accompagner l'entrée triomphale du
Duce à Berlin. Le ministre des sports du Reich, von Tschammer, prononça un discours au terme duquel la foule
chanta, le bras levé, le Deutschland über alles et le Horst-Wessel-Lied. J'eus à ce moment un petit aperçu du
délire qui pouvait saisir les masses populaires lors des grandes manifestations
de Berlin ou de Nuremberg.
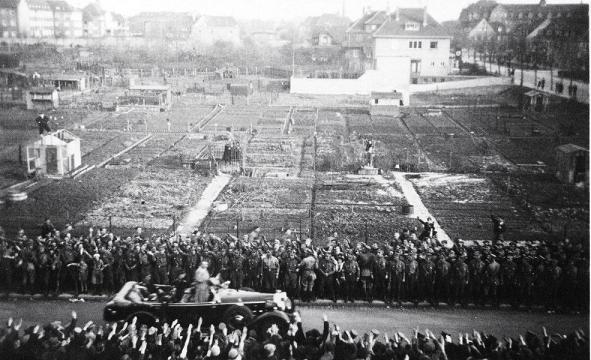
Pour en revenir à la course du Schauinsland, elle fut gagnée par le coureur allemand Hans Stuck, ce qui m'incite à raconter l'anecdote suivante :
dans les années 1980, j'entrai un jour dans un bar de la rue Musette, à Dijon,
qui était tenu par l'un de mes anciens étudiants. Celui-ci me dit que le client
debout au comptoir était un coureur automobile allemand qui s'appelait Hans Stuck. J'étais interloqué, et je racontai au patron du bar
que ce Hans Stuck avait gagné le Grand Prix de la
Montagne dans la Forêt-Noire pas loin d'un demi-siècle auparavant ! Le
mystère s'éclaircit quand le buveur, quelque peu éméché, vint s'asseoir à ma
table et trinquer avec moi à la mémoire de son père, coureur automobile comme
lui. Comme j'étais, affirmait-il, le seul Français de sa connaissance à avoir
vu courir Hans Stuck père, il m'invitait à lui rendre
visite à Munich et à pénétrer dans les coulisses du sport automobile. N'étant
pas un fanatique de cette noble distraction, je me suis toujours contenté de
fréquenter les bibliothèques munichoises, de même que les musées de peinture.
La dernière partie de mon séjour à
Fribourg a été essentiellement occupée à des activités sportives et autres avec
mon camarade Martial Depoulain, dans l'attente de
Jean Rance venu nous rejoindre avant la fin d'août. Avant la mi-août, en effet,
Helmuth et Richard étaient partis faire une randonnée
en Franconie avec leur unité de HJ. J'avais eu l'intention de partir avec eux,
mais j'en fus dissuadé par Madame Kulke, qui m'assura
que ces sorties à vélo étaient épuisantes et qu'il valait mieux attendre
sagement l'arrivée de Jean Rance. De plus, le proviseur Storck
et le professeur d'allemand Haug, tous deux Alsaciens, avaient promis leur
visite. Le premier ne vint pas et le second passa en mon absence. En tout état
de cause, l'objet principal de la susdite randonnée était surtout de visiter
les hauts lieux du parti nazi, comme l'esplanade des congrès de Nuremberg.
C'est ce qui ressort des deux cartes postales que m'ont envoyées de là-bas Helmuth et Richard. Il n'y est pas question du Nuremberg de
Dürer et des humanistes, ni des monuments exceptionnels que je n'ai pu voir
qu'après la guerre, c'est-à-dire après d'épouvantables destructions.
Le 14 août, je rends compte à mes
parents de mes activités : excursion au Titisee avec baignade dans le lac,
sortie au sommet du Rosskopf et au château de Zähringen, exercices de brasse coulée à la piscine. Tout
cela en compagnie de Martial Depoulain avec lequel
j'allais aussi au stade tout proche et au centre ville. À noter que la piscine
était interdite aux Juifs et très fréquentée par les Français. Quant à nos
escapades en ville, elles étaient parfois l'occasion de facéties de potaches
d'un goût plus ou moins douteux. Nous glissions par exemple des pièces de
monnaie françaises dans les distributeurs automatiques de bonbons. Nous
remplacions le « Heil
Hitler » de rigueur par un « À
poil Hitler », formule osée qui aurait pu nous attirer quelques
désagréments !
Je confesserai même, presque 70 ans
après, un horrible péché contre l'ordre, la discipline, voire la bienséance. Je
narrerai l'affaire en deux mots : un jour que nous revenions à pied de la
ville, Martial et moi, et que nous avions peut-être absorbé trop de liquide,
nous décidâmes dans l'urgence de nous soulager derrière un arbre, et cela au
moment précis où passaient des cyclistes qui nous injurièrent copieusement. Peu
après, le même cas de figure se représenta. Désireux de ne pas choquer à nouveau
les Fribourgeois par nos mœurs agrestes de campagnards haut-saônois,
nous nous réfugiâmes dans une cabine téléphonique ! J'en demande pardon,
presque trois quarts de siècle plus tard, à l'administration des
télécommunications.
Cette épopée fribourgeoise tirait à
sa fin. Je repris le chemin de la France au bout de cinq ou six semaines, par
un train qui allait à Vieux-Brisach. Je passai le
pont du Rhin à pied pour retrouver mes parents qui m'attendaient à
Neuf-Brisach. J'avais dans ma valise un short de la HJ et un disque que j'avais
acheté dans un magasin de sport. J'avais caché dans mes chaussettes un couteau
de scout en bon acier de Solingen. Le short a disparu depuis longtemps, le
couteau a été volé, mais je possède toujours le disque, que j'ai lancé jadis
dans le verger de Quincey et qui, avec quelques
insignes à croix gammée devenus des objets historiques, est à peu près le seul
souvenir de cette époque lointaine.
Par contre, le bilan intellectuel et
moral de ce séjour en Bade a été immense. Jamais nous n'avons pu, mes camarades
et moi, oublier cette expérience unique que fut la confrontation avec un régime
qui devait peu après bouleverser l'Europe et déclencher le plus terrible des
cataclysmes. L'offensive de paix hitlérienne nous avait permis de connaître
encore les derniers reflets de la vieille culture allemande. Mais déjà la
lumière crépusculaire dans laquelle baignait le Troisième Reich n'annonçait
rien de bon. Nous admirions certes le dynamisme et l'organisation de la
jeunesse, mais au fond de nous-mêmes nous sentions bien qu'il se passait
au-delà du Rhin quelque chose de très inquiétant, dont nous ne pouvions prévoir
les suites.
J'anticiperai largement en évoquant à
nouveau la table ronde que nous avons organisée, mes anciens camarades et moi,
en 1997 à la SALSA de Vesoul. Il m'avait paru indispensable de profiter du 60ème
anniversaire de notre séjour pour faire revivre une époque dont les jeunes
générations n'ont plus aucune idée. Les détails souvent pittoresques sur la vie
et la société allemandes qui sont restés dans les souvenirs prouvent que ces
séjours ont profondément marqué les jeunes que nous étions. Ils sont aussi une
preuve de la diversité des comportements dans une Allemagne que la propagande
de Goebbels prétendait absolument monolithique. Je pense que mes amis Ladouce et Rance ne me démentiraient pas sur ce point.
Mon retour à la maison me donna
l'occasion de raconter à la famille et aux amis ce que j'avais vu et vécu au
pays d'Hitler. Je lançais chaque jour mon disque dans le verger, mais mon
séjour en Allemagne m'avait fait manquer le Tour de France, que suivaient
parfois les jeunes Allemands que je connaissais. Une équipe nationale allemande
y participait.
Notre région était par ailleurs
concernée par deux événements sportifs de première importance : la course
Paris-Belfort et la Coupe de France de football.
Paris-Belfort, que j'avais déjà vu
passer à l'époque d'Arpenans, était une épreuve
d'endurance de
À ce propos, je ne me souviens plus
d'avoir joué au tennis avec Pierre Vuillemin à Villersexel en septembre 1937.
En tout cas, nous sommes allés ensemble, avec sa mère, à l'Exposition
Universelle de Paris. Le 14 septembre, j'écrivais à mes parents que nous étions
un peu fatigués parce que nous avions visité une douzaine de pavillons
étrangers, dont celui de l'URSS, qui était le plus impressionnant de tous.

Le lendemain matin, nous devions voir
les pavillons des provinces, et, le soir, nous assistions aux feux d'artifice
et aux illuminations de la Tour Eiffel. De ces journées très occupées, de cette
masse d'impressions ne surnage dans ma mémoire que le spectaculaire face à face
des pavillons russe et allemand, dont les proportions monumentales devaient
symboliser la grandeur des deux dictatures. L'exposition permettait
d'entretenir encore un peu l'illusion de la paix.
J'y ajouterai, dans le domaine de la
technique moderne, la découverte d'une invention qui devait plus tard
révolutionner le monde : la télévision. Au pied de la Tour Eiffel, dans le
pavillon de la Radio, de la Télévision et de la Presse, j'ai pu converser avec
Pierre Vuillemin, que je voyais sur un écran et qui était dans une autre cabine
à quelque distance de moi. Nous trouvions cette invention amusante, mais sans
nous douter de ses conséquences.
Le 1er octobre 1937,
j'entrai en classe de seconde. Notre professeur d'allemand était, pour la
cinquième année de suite, Haug dit Patoche. Affichant de plus en plus
ses sentiments germanophiles, pour ne pas dire plus, il eut l'idée de nous
faire faire des exposés sur nos récents séjours en Allemagne. Pédagogiquement
parlant, cette initiative était louable, mais visiblement Haug attendait de
nous une apologie du régime national-socialiste. Il eut l'idée saugrenue
d'afficher dans la classe les documents que nous avions apportés pour illustrer
nos exposés. Le proviseur Storck ne tarda pas à en
être averti. Il fit disparaître les photographies, croix gammées et autres
emblèmes inopportuns. Il y a tout lieu de penser que survint, entre les deux
Alsaciens, une explication orageuse. Dans le courant de l'année, certains de
nos camarades n'hésitèrent plus à engager de vives controverses avec leur
professeur au sujet de l'apologie qu'il faisait de l'Allemagne hitlérienne.
Cette année 1937-1938 commença bien
pour moi, avec plusieurs places de premier et les félicitations du conseil de
discipline au mois de décembre. Même en mathématiques, je progressais et
j'étais dans le premier quart de la classe. C'est alors que je tombai malade
dans les derniers jours de l'année. Le Dr Championet,
médecin du lycée, ne savait pas ce que j'avais. Ma mère fit alors venir de
Villersexel le Dr Chatelot, l'oncle de Pierre
Vuillemin. On conclut finalement à une paratyphoïde. Mes parents m'avaient
installé dans la salle à manger, plus facile à chauffer et plus près de la
cuisine. J'avais beaucoup de fièvre et je rêvais de boissons fraîches. Je ne
sais pas combien de temps j'ai passé couché, sans doute le plus gros de
l'hiver. Ce fut la plus grave et la plus longue maladie de mon existence.
J'avais perdu beaucoup de poids et pour me rétablir ma mère me faisait manger
des gaudes, d'après une recette d'Ernestine, l'épicière de Fougerolles. C'est
alors que j'appris à préparer moi-même ce plat traditionnel des Comtois.
Je crois n'avoir pas pu retourner au lycée avant
Pâques, c'est-à-dire en tant que demi-pensionnaire. Comme j'y allais à vélo, Ostré, notre professeur de gymnastique, me conseillait de
ne pas forcer sur les pédales dans les côtes.
De son côté, Madame Kulke m'écrivait en janvier que tous mes amis de Fribourg
espéraient me voir redevenir « le
vieil Hercule » (der alte Herkules) que j'étais
auparavant ! Elle ajoutait que je n'avais pas de souci à me faire pour mes
études et que je devais faire confiance à la vie et à l'affection de mes
parents. Elle m'invitait même à retourner chez elle pour ma convalescence.
Début février, elle m'informait que la HJ avait choisi comme devise pour 1938
le terme de Verständigung (entente) et elle
soulignait le fait que nous avions déjà appliqué cette idée en 1937.
En mars et en septembre, le Führer
allait la concrétiser d'une façon très particulière… par l'Anschluss, puis par
les accords de Munich. Le 12 mars, Hitler envahit l'Autriche, qui fut annexée
sans coup férir. Il réalisa, sans réaction des puissances occidentales, le
vieux rêve de la Grande Allemagne. Le 10 avril, un plébiscite entérina
l'Anschluss à 99%.
Pendant ce temps, je reprenais une
vie normale, essayant de rattraper le temps perdu. Pour me consoler, mon père
m'avait acheté une carabine. J'en rêvais depuis l'époque d'Arpenans,
quand je lisais le catalogue de Saint-Étienne. C'était une arme très simple,
peu puissante, d'un calibre de
Au lycée, je tentais de reprendre
pied. Mes résultats du troisième trimestre ne furent pas si mauvais, puisque
j'obtins les félicitations du conseil de discipline et quatre places de
premier. Mais rien n'allait plus en mathématiques et en physique. À la fin de
l'année, je ne récoltai que le premier prix d'allemand, à part cela des
mentions en français, latin et histoire, discipline où Mlle Madiot,
cousine de François Jamey, m'avait décerné une
excellente appréciation. Le prix spécial de l'Amicale des Professeurs, qui me
fut attribué comme l'année précédente, fut pour moi un lot de consolation.
La distribution des prix de 1938 fut
présidée par le colonel du Bessey de Contenson, commandant
d'armes et chef du 11ème régiment de chasseurs à cheval. Elle fut
introduite par le brillant discours du professeur de philosophie Marcel Decaen sur le culte de la raison et de la vérité, sur la
générosité et la tolérance, la paix, la justice et la fraternité, et contre
l'apologie de la force et de la volonté de puissance. L'allusion à la politique
était patente, et nous aurions pu, en cet été 1938, méditer ces pages. Il était
en effet de plus en plus incontestable que le Troisième Reich entretenait les
illusions concernant ses projets expansionnistes et que son chancelier était
passé maître dans l'art du mensonge.
Peu après le 14 juillet, mon
correspondant Helmuth devait venir séjourner chez
nous. En juin, il m'avait écrit de Rottweil, une petite ville située à l'est de
Fribourg. Il y était pensionnaire dans un NPEA (National-Politische Lehranstalt),
une école de formation du parti nazi où les élèves étaient soumis à une
propagande intensive et à un invraisemblable entraînement physique. Son frère Richard
suivit ensuite son exemple. Autant que je puisse en juger, c'était leur mère
qui avait pris la décision de les retirer du lycée pour choisir une carrière
militaire ou politique qui semblait alors pleine d'avenir. Madame Kulke, si évidentes que fussent par ailleurs ses qualités,
n'avait aucun sens de la politique.
Ce fut malheureusement le drame de
beaucoup d'Allemands en général et d'Allemandes en particulier, lesquelles
croyaient aveuglément à l'homme providentiel, en l'occurrence Adolf Hitler. Si
le Führer a illusionné les États européens, il a tout autant berné ses propres
compatriotes, y compris quelques grands intellectuels comme Heidegger. C'est à
dessein que je cite le nom de ce philosophe nommé recteur de l'Université de
Fribourg en 1933 et dont la conférence inaugurale est restée célèbre, car elle
révélait quelques points communs entre sa philosophie irrationaliste et
l'idéologie nazie. J'ajouterai que ce rapprochement provisoire attira au
philosophe existentialiste quelques désagréments lors de la dénazification,
même s'il avait abandonné sa fonction de recteur en 1935 et si ses conceptions
philosophiques avaient été condamnées par le régime. J'ai évoqué Heidegger
parce que son exemple a incité la famille Kulke à
adhérer au parti national-socialiste. Les deux familles étaient voisines en
1933 et le fils de Heidegger était camarade de classe de Wolfgang Kulke.
Helmuth arriva chez nous le 4 août
1938, en compagnie de Jean Rance, qui venait de passer le mois de juillet à
Fribourg. Nous fîmes, mes parents et moi, des efforts pour lui rendre ce séjour
aussi agréable que possible, en dépit du fait que Vesoul n'était pas Fribourg,
que la Haute-Saône n'était pas la Forêt-Noire et que le confort de l'école de Quincey n'était pas celui de la villa de l'Ottilienwiese.
Nous allâmes à la pêche à Scey-sur-Saône, rendre des
visites à divers amis, notamment à Paul Clavier de Quincey
et à Émile Morin de Navenne. Tous deux étaient, comme
mon père, des anciens combattants, et Helmuth aimait
beaucoup les histoires de guerre. M. Morin, ancien officier d'infanterie, était
intarissable sur le sujet. Il exhibait même un parabellum qu'il avait ramené
des champs de bataille.
Mon père nous conduisit un jour sur
ceux des Vosges, sans doute au Linge, au-dessus de Munster. Vingt ans après
1918, on y trouvait encore des restes des tranchées. Helmuth
en ramassa et rapporta pieusement ces reliques à la maison. Nous fîmes halte
dans un village du coin pour y prendre un rafraîchissement. Le forgeron du
village discuta en allemand avec Helmuth et nous dit
que c'était un fanatique… Réaction de ce dernier, indigné par ce terme : « Ich bin kein Fanatiker. »
En réalité, le forgeron n'avait pas
tort. La NPEA de Rottweil avait fait son œuvre, et le pauvre garçon avait l'air
complètement envoûté par l'idéologie nazie. Il photographiait tout ce qu'il
pouvait voir de l'armée française, bâtiments, hommes et matériel. Je me
rappelle sa réaction un jour où les gendarmes étaient venus voir mon père pour
un problème communal : il pâlit et trahit une soudaine inquiétude, croyant sans
doute qu'ils allaient l'arrêter… Mais la gendarmerie de Vesoul n'était pas la
Gestapo.
Il faisait aussi une enquête sur la
politique d'Hitler vue par les Français, demandant à tous ceux qu'il
rencontrait si, à leur avis, le chancelier voulait la guerre. Il notait toutes
les réponses sur un carnet, certainement pour en rendre compte à son école, qui
lui avait enjoint de faire un rapport sur son séjour en France.
Pour finir, j'évoquerai la visite que
nous avons faite à Fougerolles pour présenter Helmuth
à notre parenté. C'était l'époque où je circulais avec le fameux cyclomoteur de
ma tante Marie-Louise. Mon camarade fut enchanté de monter sur cet engin
pétaradant. Qui plus est, mon père nous permit de conduire sa voiture sur le
champ de foire, et Helmuth déclara que c'était
« fabuleux » (fabelhaft).
Il n'y avait en effet pas de véhicules motorisés dans sa famille. Quant à moi,
c'est à cette époque que j'appris à conduire une voiture.
Le mois de septembre 1938 connut un climat
international tendu, du fait des revendications hitlériennes au sujet des
Sudètes. Au congrès du parti à Nuremberg, le Führer fit le 12 un discours
menaçant, après quoi il rencontra Chamberlain le 15 et le 22, et dans la nuit
du 29 au 30 furent signés les accords de Munich entre Hitler, Mussolini,
Daladier et Chamberlain.
Le 26, le chancelier avait prononcé
un grand discours au Sportpalast
de Berlin, affirmant sa volonté de paix et son intention de ne plus revendiquer
de territoires à l'ouest.
« L'Alsace-Lorraine n'existe plus pour nous, avait-il déclaré. Nous sommes deux grands peuples qui veulent
travailler et vivre, et qui peuvent vivre le mieux en collaborant. »
L'offensive de paix en direction de
la France se poursuivait donc, si bien que Helmuth
pouvait m'écrire le 17 octobre que l'affaire des Sudètes était un bon exemple
de la politique de paix du Führer, qui avait réussi à éviter la guerre tout en
ramenant plus de trois millions d'Allemands dans le Reich. Tout cela était la
preuve de « la grandeur de notre
Führer. »
Pendant que la psychose de guerre se
répandait, je terminais mes vacances en passant quelques jours à Villersexel
chez Pierre Vuillemin. Les discussions sur la situation allaient bon train, ce
qui ne nous empêchait pas de jouer au tennis, de faire du vélo et de chanter
les chansons à la mode, en particulier Y' a d'la joie de Charles Trénet. Il me reste de cette dernière période de paix et
d'agréables vacances plusieurs photos de groupes nous montrant, Pierre et moi,
la raquette à la main, entourés de son élégante tante Marie-Rose, de sa sœur
Janine et de quelques autres membres de la famille. Le calme avant l'orage !
C'est en ce début d'automne que nous
eûmes, à Quincey, la visite de Paul Trélat et de sa famille. Mon père avait retrouvé chez ses
parents l'adresse de ce camarade de captivité, grand blessé qui avait été
rapatrié par la Suisse et dont il avait perdu la trace. J'étais dans le verger
avec notre professeur d'éducation physique Ostré
lorsqu'une voiture de la Haute-Marne arriva avec plusieurs personnes, dont Paul
Trélat et son épouse. On imagine la joie de mon père
lorsqu'il revit son vieux camarade du camp de Limburg-an-der-Lahn.
J'entrai en classe de première le 1er
octobre 1938. Nous avions un nouveau proviseur, Étienne, un nouveau professeur
de français et de latin, Huguet, un nouveau professeur d'allemand, Dautriche, et un nouveau professeur d'histoire, Meyer, ce
qui représentait des changements considérables auxquels il fallait s'adapter.
De plus, il me fallait combler les lacunes accumulées au début de l'année 38,
ce qui n'était pas simple dans les disciplines scientifiques. Enfin je crois
avoir été absent à certaines compositions, notamment en latin, matière où je
n'obtins que des mentions de prix. Bref, mon année de première ne fut pas très
brillante et je ne fus pas une seule fois félicité par le conseil de
discipline, ce qui n'était guère encourageant pour l'examen du premier bac qui
devait avoir lieu en juin 39. J'ajouterai que le baccalauréat à cette époque
n'avait rien de commun avec celui d'aujourd'hui.
Dans un autre ordre d'idées, les
luttes politiques du temps et la situation générale avaient naturellement des
répercussions sur notre existence de pensionnaires. Bien que passablement
absorbés par nos travaux scolaires, nous n'étions pas coupés du monde au point
d'ignorer les affrontements idéologiques du temps. Les discussions étaient
souvent vives et passionnées comme elles peuvent l'être à cet âge, d'autant
plus que certains d'entre nous venaient de faire des séjours en Allemagne,
comme je l'ai indiqué. Et puis nous lisions des journaux, comme l'Os à moëlle de Pierre Dac, qui ridiculisait Hitler et les
nazis. Mais si la dérision était une manière d'esquiver le danger, la Nuit de cristal du 9 novembre 1938, cet
inconcevable pogrom organisé par le pouvoir hitlérien, montra au monde de quoi
était capable le nazisme.
Il existait un abîme entre une
pareille idéologie et ce que nous faisait lire M. Dautriche,
notre professeur d'allemand. Il avait en effet choisi l'œuvre la plus achevée
du classicisme allemand, l'Iphigénie en Tauride (Iphigenie
auf Tauris) de Goethe.
Je ne sais pas si nous avons vraiment profité de cette lecture, qui dépassait
de beaucoup nos connaissances en littérature allemande. Toujours est-il que ce
refuge dans l'empyrée de l'idéalisme le plus pur était plus formateur que le
triste spectacle qui se déroulait au-delà du Rhin.
Cependant nous ne pouvions ignorer
les coups de force répétés du Führer qui, après avoir « sauvé la paix »
à Munich, envahissait en mars 1939 des régions peuplées de Slaves comme la
Bohême, la Moravie et la Slovaquie. Le Protectorat de Bohême-Moravie fut
institué le 23 mars. Il est clair qu'Hitler était en train de réaliser ce qu'il
annonçait dans Mein Kampf : la conquête
d'un espace vital aux dépens des Slaves. Le gouvernement britannique avait
enfin compris : il se décida le 31 mars à donner sa garantie militaire à la
Pologne. La France l'imita le 6 avril.
En ces mois dramatiques, nous étions,
comme toute l'Europe, à l'écoute des discours du vaticinateur de Berlin. Comme
il nous était difficile de saisir tout le sens du message que cet histrion
délivrait au monde, nous interrogions notre professeur d'allemand. Mais il
était malaisé de prévoir quand et comment le maître du Reich grand-allemand
allait perpétrer son prochain méfait.
En attendant, il nous fallait nous
préparer en hâte à l'examen, dont nous passâmes l'écrit en juin, dans la salle
de la rue Didon. J'étais à peu près sûr de m'en tirer dans les disciplines
littéraires, mais très inquiet concernant les mathématiques, malgré une assez
bonne note et une appréciation encourageante au dernier trimestre. Cette
matière était la seule à avoir un coefficient 3. Les résultats de l'écrit
furent déconcertants, car malgré mes efforts et mes progrès dans la susdite
discipline je n'obtins qu'une très mauvaise note. En français, où j'étais
qualifié d'excellent élève par notre professeur Huguet, je ne m'en tirai
qu'avec la moyenne, parce que j'avais choisi le sujet rebattu sur le Cid.
Je ne fus guère étonné d'être gratifié d'une très bonne note en allemand, mais
ma surprise fut grande d'atteindre 17 sur 20 en version latine, pour une
traduction de l'Énéide. Je n'étais pas peu fier d'avoir, ce jour-là,
surpassé le champion des champions, notre camarade Caquot, plus tard élève de
l'ENS, brillant agrégé de grammaire et professeur au Collège de France…
Nous fûmes, en tout et pour tout,
cinq admissibles dans notre classe de 1ère A' à passer l'oral à
Besançon, au rectorat. Mon père avait pris un jour de congé pour me conduire
sur place, ainsi qu'André Ladouce. La sœur de
François Jamey avait fait le déplacement avec sa
propre voiture, le père de Pierre Vuillemin avait amené son fils. Je n'étais
guère rassuré, car je n'ai jamais aimé les oraux d'examens. Je craignais
surtout l'interrogation de sciences physiques, matière où j'avais de grandes
lacunes depuis l'année de seconde. Ma note, sur 30, fut effectivement
désastreuse. Plus surprenante fut celle d'allemand, qui me sembla
particulièrement sévère. Par contre, je gagnai des points en
histoire-géographie, notée sur 30, et surtout en latin. Tout est bien qui finit
bien : nous fûmes tous admis, Vuillemin, Ladouce, Jamey, Anne-Marie Véleur et moi.
M. Vuillemin nous invita à arroser ces succès au café le plus proche.
Restait une formalité avant les
vacances : la distribution des prix. Elle eut lieu, comme d'habitude, le 13
juillet et fut présidée par un ancien polytechnicien qui avait fait ses études
au Lycée Gérome. Le discours d'usage fut prononcé par
Pierre de Saint-Jacob, agrégé d'histoire, que j'ai précédemment cité. Le titre
en était : La révolution française et l'enfant, sujet tout à fait
d'actualité puisque c'était à la veille du 150ème anniversaire de
1789. Cette année-là, ma récolte de prix fut moins bonne que de coutume, hormis
celui de l'Association des Professeurs, que j'obtins avec François Jamey. Quant à André Caquot, il reçut deux prix spéciaux,
et Pierre Vuillemin celui de culture générale.
Au fond, il m'importait surtout
d'avoir réussi au baccalauréat, qui à cette époque n'était pas une simple
formalité. J'aurais pu jouir ensuite de reposantes vacances si Hitler n'avait
pas continué à ourdir ses sombres machinations. Le 22 mai, il avait signé avec
l'Italie une alliance militaire appelée Pacte d'Acier, et en juillet il
commençait à réclamer le retour de Dantzig à l'Allemagne et la suppression du
fameux Corridor.
Le 14 juillet 1939 fut marqué par les
festivités du bicentenaire de la Révolution. Le défilé traditionnel, à Paris,
fut particulièrement splendide, car il devait célébrer à la fois la fête
nationale et l'Entente cordiale avec la Grande-Bretagne. De plus, il s'agissait
de rassurer l'opinion en lui montrant la puissance de l'armée française.
À Quincey,
la population fêtait à sa manière ce grand jour. Deux photographies font
revivre le rassemblement des élèves, les écolières en robes blanches, les
instituteurs et les habitants du village en grande tenue. La municipalité
offrit un goûter aux enfants et un banquet républicain le soir aux élus. Mon
père, secrétaire de mairie, ma mère institutrice étaient invités, ainsi que
moi.
 Ce
fut une bien belle journée, mais nul ne se doutait que, moins d'un an après, la
Troisième République aurait disparu, à l'âge de 70 ans.
Ce
fut une bien belle journée, mais nul ne se doutait que, moins d'un an après, la
Troisième République aurait disparu, à l'âge de 70 ans.
Le 23 août, le Reich signa avec l'URSS
le pacte germano-soviétique. Le 1er septembre, Hitler envahit la
Pologne. Le 3, la France et le Royaume-Uni déclarèrent la guerre à l'Allemagne
en vertu des accords militaires qui les liaient à la Pologne. Ces jours-là, des
dames de bonne volonté passèrent dans les maisons pour récolter des signatures
en faveur de la paix. Effort louable, certes, mais dérisoire face à la
détermination d'Hitler et de Staline, qui entra en Pologne le 17 septembre.
Alors commença la "drôle de
guerre", attente angoissante des Français repliés derrière la Ligne
Maginot, tactique purement défensive d'un état-major fermé aux idées modernes,
crainte obsédante de la "cinquième colonne", c'est-à-dire de
l'espionnage.
La propagande s'efforçait de
maintenir l'illusion. En décembre 1939, Ray Ventura et Paul Misraki
adaptèrent une chanson anglaise sous le titre de On ira pendre notre linge
sur la Ligne Siegfried.
On affichait ce slogan pour entretenir le moral du
peuple :
Nous vaincrons parce que nous
sommes les plus forts …