Chapitre 11
Quincey,
prélude du Lycée Gérome
Nous quittâmes Arpenans en septembre 1932. J'en eus un peu de regret. Mais j'avais un espoir, un rêve, celui d'obtenir un couteau à plusieurs lames, du genre couteau suisse, qui serait bien utile pour construire des huttes de branchages comme je l'avais fait à Arpenans avec mes petits copains. J'en avais admiré des modèles dans le catalogue de Manufrance et peut-être aux vitrines des boutiques de Lure, et je savais qu'à Vesoul la coutellerie Pradel, près du pont du Durgeon, pourrait me fournir ce précieux objet. Je pensais profiter de notre déménagement pour réaliser mon vœu. Malheureusement, il n'en fut rien. Mes parents avaient bien d'autres choses à faire et mon achat fut reporté aux calendes grecques.
À part
cela, le déménagement ne m'a pas laissé beaucoup de souvenirs, sauf une
anecdote assez burlesque à propos d'une cafetière. Ma mère, voulant offrir du
café aux déménageurs, en l'occurrence des amis d'Arpenans et mon oncle Jean
Nurdin, sortit prestement sa cafetière des cartons sans prendre le temps d'en
vérifier le contenu. Le résultat fut désastreux. Le café était imbuvable. Il
avait été fait avec une boîte d'épingles et un thermomètre médical, ce qui
donna à mon oncle l'occasion de faire quelques plaisanteries caustiques…
Concernant
les caractéristiques géographiques et historiques de notre nouveau lieu de
résidence, nous n'avions pas perdu au change. Au fond de sa campagne, Arpenans
était un village sans histoire. Par contre, Quincey se signalait par ces deux
curiosités géologiques que sont le Frais-Puits et la Font de Champdamoy, deux
résurgences d'un vaste réseau hydrographique souterrain propre aux calcaires
jurassiques.
La
géographie conditionnant souvent l'histoire, les grottes de Champdamoy ont été
habitées dès les époques paléolithiques et néolithiques, donc bien avant
l'apparition dans les annales féodales d'une lignée seigneuriale dite « de
Quincey », qui régna durant quatre siècles, jusqu'à l'acquisition du fief
en 1613 par Étienne de Mesmay. C'est par l'intermédiaire de son descendant,
Jean Antoine de Mesmay, conseiller au Parlement de Besançon, que Quincey entra
d'un seul coup dans l'histoire nationale.
Les
événements survenus au château le 19 juillet 1789, à savoir l'explosion d'un
baril de poudre confondu avec un tonneau de vin, suivie de l'incendie et du
pillage de la demeure seigneuriale, déclenchèrent un mouvement de panique dit la Grande Peur, et par contrecoup un
mouvement d'association qui aboutit à la grande Fête de la Fédération, célébrée
le 14 juillet 1790 à Paris et dans les provinces. Comme cette date marque en
somme la naissance de la nation française, il n'est pas interdit de penser que
ce que les historiens ont nommé « l'incident de Quincey », et qui se
répercuta jusqu'à Paris et à Versailles, eut quelque influence sur la formation
du sentiment national des Français.
Notre
nouveau cadre de vie nous offrait d'intéressantes possibilités de détente et de
distraction, non seulement à cause de la proximité du chef-lieu du département,
mais aussi parce que la commune comprenait de vastes espaces de prés, de bois,
de friches, et des paysages passablement variés. L'existence au sein de cette
nature ne manquait pas d'agréments. À l'époque déjà, Quincey joignait les
avantages de la campagne à ceux de la ville.

Toutefois
nous étions perdants concernant le logement. L'ancienne école était un bâtiment
exigu, mal placé entre la rue principale et des maisons qui la serraient de
près. Les élèves ne disposaient que d'un espace restreint dans des cours de
récréation trop petites. Quant au jardin de l'instituteur, il était grand comme
un mouchoir de poche.
Le logement
de fonction, au premier étage, comprenait cinq pièces en enfilade, dont
certaines ne recevaient qu'avec parcimonie la lumière du jour. Il y avait
aussi, au bout du grenier, une mansarde bien éclairée dont la fenêtre donnait
dans la direction de Vesoul et de la Motte. Je m'y installais souvent l'été
pour lire.
Bien
entendu, cette maison d'école était totalement dépourvue du confort le plus
élémentaire, comme c'était le cas à l'époque dans tous les villages. Le
problème de l'eau était crucial. Il fallait la transporter dans des seaux
depuis la place de la fontaine. La corvée d'eau était donc beaucoup plus
pénible qu'à Arpenans, où la fontaine était devant l'école.
Un autre
inconvénient était l'absence de garage pour la voiture de mon père. Si ma
mémoire est bonne, il la rentra au début dans l'ancien presbytère, près de
l'église.
Mais
c'étaient là, finalement, des incommodités plutôt mineures. Dans l'ensemble,
notre adaptation fut facile. Nous avions la boulangerie et l'épicerie au même
endroit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire à deux pas, et il y avait au village assez
de fermes pour se fournir en lait, en œufs, en volailles et en lapins. Pour les
autres achats, les magasins et le marché de Vesoul n'étaient pas loin.
En ce
temps-là, Quincey était encore un village très rural, avec une minorité
d'ouvriers employés dans les entreprises vésuliennes. Mais la plupart d'entre
eux restaient attachés à leur terroir et s'occupaient activement de leurs
jardins dans leurs moments de loisirs. Certains avaient des élevages de moutons
et cultivaient même quelques vignes qui donnaient un vin plutôt râpeux. Tous
les habitants avaient droit à l'affouage et je garde le meilleur souvenir
d'après-midis ensoleillés passés à couper du bois les jeudis de février et de
mars.
Comme à
Arpenans, je n'ai pas mis longtemps à m'intégrer et à trouver des compagnons de
jeu. Mes premiers contacts eurent lieu dès mon arrivée, avec nos deux plus
proches voisins, qui habitaient dans l'impasse : Charles Cornu et Gilbert
Leytre. Par la suite, toute une équipe se constitua à partir de la rentrée
d'octobre 1932. Nous avions un vaste champ d'action, notamment dans les
vergers, les prés, les vignes et les bosquets qui s'étageaient le long des
coteaux. J'avais aussi un copain au bas du village. Son père était vosgien et
travaillait à la scierie. Nous faisions des parties de pêche dans la Colombine.
J'ai passé
une année scolaire dans la classe de mon père, avec quelques-uns des vieux amis
qui me restent. La salle était la première en entrant, du côté de la route, et
la classe des petits, celle de ma mère, était celle de gauche, vers le fond de
l'impasse.
Autant que
je sache, mes parents prenaient là une succession assez difficile.
L'institutrice qui les avait précédés, Madame J., était quelque peu débordée
par des garnements qui avaient la bride sur le cou. Son mari, professeur à l'École
Normale de Vesoul, tentait bien de remettre un peu d'ordre dans la maison, mais
sans grand succès.
La première
tâche de mon père consista donc à faire régner la discipline, et cela par la
méthode la plus directe, je veux dire par la distribution de quelques taloches.
Cette vieille pratique de jadis conduirait à présent l'enseignant devant les
tribunaux. À cette époque, elle était admise par les parents, qui du reste
l'appliquaient à la maison.
La seconde
tâche consista ensuite à hausser le niveau scolaire en vue de faire réussir le
maximum d'élèves au Certificat d'études primaires. Je crois que mes parents
l'ont assumée avec diligence, si j'en juge au nombre de réussites à l'examen,
et d'après l'opinion de leurs anciens disciples.
 L'école
de Jules Ferry était bien différente de celle d'aujourd'hui dans son esprit et
ses méthodes. Elle n'avait pas pour objectif d'amuser et de distraire, mais
d'éduquer les citoyens. Les cours de morale, d'instruction civique et d'hygiène
y jouaient un rôle important.
L'école
de Jules Ferry était bien différente de celle d'aujourd'hui dans son esprit et
ses méthodes. Elle n'avait pas pour objectif d'amuser et de distraire, mais
d'éduquer les citoyens. Les cours de morale, d'instruction civique et d'hygiène
y jouaient un rôle important.
De plus,
les élèves n'étaient pas des sortes de consommateurs venant à l'école en
amateurs, comme dans un supermarché. Ils participaient à la vie de
l'établissement en exécutant de petits travaux d'entretien, y compris le
rangement du bois de chauffage dans les bûchers, et de menus travaux de
jardinage. Les enfants adoraient en général coopérer ainsi avec le maître.
Ainsi naissait un esprit d'équipe.
Mon père
assura aussi le secrétariat de mairie, qui jusqu'à la guerre ne posa guère de
problèmes. C'est grâce à cette fonction qu'il gagna la confiance du maire de
l'époque, qui au premier abord s'était montré plutôt méfiant. Sous la Troisième
République, les maires et d'autres élus qui avaient leurs entrées à la
préfecture et dans les administrations du chef-lieu de département tentaient
parfois d'influer sur la nomination des instituteurs. L'édile déclara à mon
père, qui tombait des nues, qu'il voulait s'opposer à sa nomination parce qu'il
était membre du Parti Communiste. Le malentendu fut heureusement bientôt
dissipé, mon père étant à la SFIO et non au PCF.
La
proximité de Vesoul nous permettait d'y aller fréquemment pour y faire des
emplettes, rendre des visites ou rencontrer des amis. Ma mère achetait à
l'épicerie fine Lachiche, des gâteaux chez Burtz, des vêtements chez Ravatin,
des livres à la librairie Bon. Elle fréquentait le marché du jeudi matin et y
rencontrait bien des personnes de connaissance. Le dimanche était plutôt
réservé aux loisirs, culturels ou sportifs. En vérité, à part deux cinémas,
l'activité culturelle de Vesoul était fort limitée.
Hormis deux
ou trois clubs sportifs comme l'Avant-Garde
de la Motte et le Racing Club
Vésulien, le sport associatif était beaucoup moins développé qu'à présent.
Mon père, amateur de football, ne manquait pas d'assister aux matches du
Racing, qui se déroulaient sur le terrain des Allées. Il se rendait ensuite
volontiers au Café de l'Union, qui existe toujours près de la Place de la
République. À cette époque, cet établissement était tenu par les parents de
Robert Marguerite, qui fut plus tard professeur au Lycée Gérome et d'abord
notre condisciple.
Par
ailleurs, nous avions à Vesoul quelques bons amis, comme les Defranoux, un
couple de personnes âgées qui habitaient au Boulevard de Besançon et chez qui
maman sortait le dimanche lorsqu'elle était à l'École Normale. M. Defranoux
avait jadis travaillé dans la tonnellerie de mon grand-père.
Autres
Fougerollais vivant dans le même quartier : Émile Ougier et son épouse. Émile
était le fils du fidèle ami de mon grand-père, Eugène Ougier. Je me souviens
encore des parties de pêche aux écrevisses que nous faisions ensemble, du côté
de Bougnon ou ailleurs.
Ajoutons à
ces vieilles amitiés celle qui liait ma mère à Marcelle Cival, devenue Madame
Baptizet, qui était la fille de l'imprimeur Cival. C'est dans cette famille que
sortaient le dimanche, avant 1900, mon oncle Henri et les fils Peureux quand
ils fréquentaient le lycée.
Outre ces
très anciennes relations, nous avions des rapports très cordiaux avec les
collègues vésuliens de mes parents, en particulier les enseignants des écoles
du Centre et du Boulevard, ainsi qu'avec ceux d'Échenoz.. J'ai toujours en
mémoire les visites chez M. Rabasse, le directeur du Cours Complémentaire, qui
habitait rue de Cita. Comme je l'ai déjà indiqué, je l'avais connu à Arpenans,
où il possédait une maison de vacances. Il faut signaler qu'il existait une
certaine rivalité entre le lycée et le cours complémentaire, le secondaire et
le primaire.
Dans ce
contexte, un événement marquant survint en 1934 chez les instituteurs. En 1934,
en effet, quelques-uns d'entre eux fondèrent à Niort la Mutuelle Assurance
Automobile des Instituteurs de France (MAAIF), initiative révolutionnaire, à
replacer dans le cadre du mouvement social des années 1930. Mon père y adhéra
d'emblée et assuma bientôt les fonctions de secrétaire de la section
haut-saônoise. Au lendemain de la guerre, sa photographie figurait encore dans
l'annuaire de la MAAIF, devenue depuis longtemps la MAIF.
Ces
activités mutualistes renforcèrent encore les liens d'amitié qu'il avait avec
ses collègues de Vesoul et des environs, notamment Pierre Martin, Maurice Morel
et Henri Ferry. Les deux derniers, de surcroît, habitaient Quincey et venaient
quelquefois chez nous à la veillée. M. Morel enseignait à Vesoul, Madame Morel
à Frotey, et leur maison est toujours dans le bas du village, face au
carrefour. Quant à M. Ferry, il vivait alors avec sa mère, dans la maisonnette
située en bordure de l'ancienne propriété de Jean Morel.
Au terme
des vacances de l'été 1933, mon existence prit une tournure nouvelle. Une période
décisive de ma vie commença, voulue par ma mère qui atteignait enfin à son but
: me mettre en pension au lycée.
Les
opérations débutèrent le 30 septembre après-midi, car il fallait installer les
pensionnaires, déposer leur trousseau préparé depuis longtemps, visiter les
dortoirs et accomplir des démarches avec l'administration.
Au
vestiaire du dortoir, je fus guidé par un garçon qui était au lycée depuis un
an. Il s'appelait Gilbert Garny. Je n'étais d'ailleurs pas seul, mais en
compagnie de mon camarade Jean Gaspard, que je connaissais depuis le temps
d'Esmoulières. Ses parents étaient eux aussi descendus des Vosges saônoises et
enseignaient à Bussière, près de Vorey-sur-l'Ognon.
Toutes les
formalités accomplies, nous repartîmes tous, parents et enfants, passer une
heure ou deux en ville. Attablés à une terrasse de café, pères et mères firent
leurs dernières recommandations avant le retour au lycée, pour 19 heures. Car
c'était ensuite le moment du repas, qu'il fallait impérativement respecter.
Le soir, je
fis la connaissance de mon voisin de lit. Il était de Scey-sur-Saône et
s'appelait Jean Rance. J'avais le numéro 23, et lui le 24.
Les choses
sérieuses commencèrent le lendemain, 1er octobre, à 6 heures. Le pion
fit sortir du lit la quarantaine de potaches du dortoir. Il fallut se laver à
l'eau froide, s'habiller et descendre en étude, attendre 7h30 pour déjeuner au
réfectoire, et à 8 heures se retrouver en classe.
Après trois
ou quatre heures de cours, on nous alimentait à nouveau, et ensuite nous avions
le droit de respirer l'air de la cour de récréation jusqu'à 13h30. Une
demi-heure d'étude précédait les classes de l'après-midi, qui duraient deux
heures. Nouvelle détente en récréation jusqu'à 17 heures, et de 17 à 19 heures
travail personnel en étude d'externat, avant le repas du soir qui était précédé
d'une nouvelle heure d'étude jusqu'à 20 heures. À 21 heures, tout le monde
était couché et dormait du sommeil du juste.
Comme on
peut le constater, la journée d'un potache avait des allures monacales. D'ailleurs
le lycée était une ancienne école de Jésuites fondée au début du 17ème
siècle et agrandie sous le Second Empire. Pour des enfants venus de la
campagne, ces murs gris et austères, ces longs couloirs plus ou moins sombres,
ces salles passablement rébarbatives n'avaient rien d'attrayant. Le bâtiment
scolaire voisin, l'École Normale d'institutrices où ma mère avait fait ses
études, était infiniment plus agréable.
La vie,
surtout en hiver, était spartiate dans ces locaux mal chauffés et mal éclairés.
Tomber du lit à 6 heures du matin dans un dortoir plutôt glacial, se laver en
hâte à l'eau froide dans un lavabo en zinc, passer une heure à réviser les
leçons dans une étude où le poêle commençait tout juste à chauffer, tout cela
n'avait rien d'une partie de plaisir. Ce n'est qu'à 7h30 que nous pouvions
enfin avaler un bol de café au lait agrémenté de pain sec et, le cas échéant,
de beurre ou de confiture apportés de la maison. Car nous avions, heureusement,
quelques provisions dans nos cassettes.
Quant à l'hygiène,
elle était réduite au minimum. Nous avions droit à une douche par semaine, ou
même peut-être tous les quinze jours.
Les
premiers jours, ce régime me parut dur à supporter, d'autant plus que je savais
mes parents à peu de distance, et qu'à part Jean Gaspard je ne connaissais
personne. Je fus pris de panique quand le professeur d'allemand, Haug, me
confondit avec un élève dissipé de l'année précédente et me fit asseoir au
premier rang. Cette méprise n'eut pas de suites, car le maître me mit une très
bonne appréciation sur mon premier bulletin trimestriel. Il en était de même
partout, sauf en mathématiques où, malgré l'effort de mon père au cours de ma
dernière année d'école primaire, j'éprouvais encore des difficultés.
Ces
tendances générales se confirmèrent durant toute mon année de 6ème,
et par la suite jusqu'en 1ère : réussite dans les matières
littéraires et en éducation physique, difficultés dans les disciplines
scientifiques.
Mon année
de 5ème fut moins bonne que la 6ème et surtout que la 4ème,
au cours de laquelle je reçus les félicitations du conseil de discipline à
chaque trimestre, malgré une absence assez longue. Il est vrai que mon père
m'avait sérieusement admonesté au cours de la 5ème et que nous
avions changé de professeurs de français et de latin. MM. Tartarin, Jamey et
Malrieu avaient remplacé Pagney, et en histoire Miège avait succédé à
l'épouvantable Lanoir, parti exercer ses talents au Prytanée militaire de La
Flèche.
Une
véritable révolution survint à la rentrée d'octobre 1935, lorsque Storck, le
nouveau proviseur, prit la succession de Vincent, dit le Tachu. À la
place d'un homme plus ou moins sénile, dont les quintes de toux résonnaient
dans les couloirs, on nous envoya un Alsacien vigoureux et énergique, à la fois
à cheval sur les règles de la discipline et du travail et large d'esprit. C'est
ainsi qu'il nous permit, chose inouïe, d'aller au cinéma environ une fois par
mois.
Il avait en
revanche une façon de rétablir l'ordre, dont je donnerai deux exemples.
Quelques énergumènes ayant déclenché la nuit une bataille de polochons, il
condamna tout notre dortoir à se lever plusieurs jours de suite à 5 heures du
matin. Une autre fois, il distribua une volée de gifles à un jeune Juif
allemand nommé Schick, pour le punir d'avoir maltraité des camarades plus
petits. Ses invectives dignes d'un feldwebel de l'armée prussienne rappelaient
qu'il avait combattu sur le front de l'Est sous Guillaume II. Cela dit, Storck
était un bon patriote français, ce qui n'était pas le cas de notre professeur
d'allemand Haug, dit Patoche.
Après avoir dirigé, pendant la Seconde Guerre mondiale, le lycée Gay-Lussac de Limoges, Storck termina sa carrière en Alsace, comme inspecteur d'académie du Haut-Rhin.
La vie des
pensionnaires d'autrefois n'avait aucune commune mesure avec celle des lycéens
actuels. Nous restions presque toute la semaine claquemurés au bahut, ce
qui ressemblait assez à la claustration de nos voisins, les prisonniers de la
maison d'arrêt. Pour mon compte personnel, j'étais favorisé puisque je pouvais
rentrer à la maison le jeudi et le dimanche. En outre, à partir de Pâques je
n'étais plus interne, mais demi-pensionnaire. Je partais de Quincey à vélo vers
7h30 et je rentrais le soir vers 19h30. Les premiers jours, au printemps de
1934, ma mère s'inquiétait un peu. De la fenêtre de la mansarde, elle me
suivait à la jumelle quand je traversais la plaine de Frotey. Il n'y avait
guère de danger sur les routes, hormis les plaques de verglas au début du
printemps.

Le lycée
comprenait plusieurs cours, dont deux étaient encadrées par les bâtiments : la
cour des externes, dans la partie la plus ancienne de l'établissement, et la
cour d'honneur. Les récréations se passaient derrière les bâtiments, dans un
vaste espace limité par des murailles, notamment celle qui donnait du côté de
l'École Normale de filles, au pied de la Motte. C'est aussi de ce côté que se
trouvait l'école d'agriculture d'hiver.
Les
récréations étaient surtout occupées à faire des parties de football. Quand le
ballon tombait dans le parc de l'École Normale et que les normaliennes le
renvoyaient par-dessus le mur, tout le monde était aux anges.
Près de la
cour de récréation, il y avait un court de tennis, chose rare dans les vieux
lycées de l'époque. Nos professeurs n'y venaient guère, excepté notre
professeur de dessin, Micheau dit La Gouache. Nous avions par contre des
camarades qui y faisaient bonne figure. C'est là que j'ai commencé, avec une
raquette que je garde en souvenir, ma modeste carrière de tennisman.
Non loin de
là se trouvait le gymnase où M. Ostré nous enseignait l'éducation physique. Le
local et le matériel étaient plus que rudimentaires. Il faut dire que, malgré
la maxime de Juvénal, souvent citée lors des distributions de prix, Mens
sana in corpore sano, beaucoup de forts en thème mettaient un point
d'honneur à être nuls dans les disciplines sportives.
C'était un
grand moment dans une année scolaire que la fête du lycée. Un certain nombre
d'élèves la préparaient avec soin, répétant assidûment les morceaux de musique
et les pièces de théâtre qui devaient être interprétés devant un public de
camarades et de parents.
Je retrouve
dans le programme de 1934 les noms de deux de nos condisciples, Jean Gaspard,
qui joua au violon la Marche turque, et Pierre Vuillemin, qui exécuta
une chacone au piano. René Jançon, fils de l'instituteur de Vaivre, débita deux
monologues et interpréta le rôle de Léandre dans le Médecin malgré lui,
où Albert Chassagne jouait Sganarelle.
Je relève
dans un autre programme des noms également connus, comme celui de Jeanne
Monnot, aujourd'hui Madame Chemithe, de Marie-Louise Nauroy, fille de notre
professeur de sciences naturelles, et de Renée Travaillot, qui fut plus tard
professeur au lycée.
Ces fêtes
donnaient aux élèves l'occasion de faire preuve de leurs talents, ce qui
n'était pas mon cas. Comme je l'ai dit précédemment, ma mère m'avait fait
apprendre le violon à Lure. Je continuai à prendre des leçons à Vesoul, mais
mon maître, Samson, n'était pas très sympathique et je n'étais pas très motivé.
D'autre part, j'avais de plus en plus de travail scolaire, si bien que maman
abandonna la partie, à son grand regret.
J'eus ainsi
davantage de temps à passer à Quincey le jeudi, jour de sortie. Si je me
souviens bien, mes parents venaient me chercher au lycée dans la matinée. Nous
allions au marché, où l'on rencontrait toujours des personnes de connaissance.
L'après-midi consistait la plupart du temps à faire des devoirs, sauf si
j'avais à jouer au football sur le terrain des Allées. En tout état de cause,
il fallait retourner au bahut pour le repas de 20 heures. La permission
du dimanche était un peu plus longue, car j'avais le droit de sortir le samedi
soir après l'étude, à savoir à 19 heures.
Un jour,
mon père vint me chercher un peu plus tôt. Il eut par la suite des ennuis avec
la direction, qui menaçait de me faire passer devant le conseil de discipline. À
l'époque, on ne plaisantait pas avec le règlement.
Le dimanche
à Quincey me permettait de dormir, mais j'avais aussi du travail à faire, en
général du latin et de l'allemand, langue que mes parents avaient apprise à
l'école, surtout ma mère chez Mademoiselle Foltzer, une Alsacienne qui
enseignait à l'École Normale de Vesoul. Maman en savait encore assez pour
m'aider dans mes débuts. Quant au latin, j'étais obligé de me débrouiller seul
dans cette discipline difficile, mais où je réussissais bien.
Le dimanche
comme le jeudi, il fallait impérativement rentrer au lycée avant 20 heures.
Le lundi à
8 heures, nous retrouvions en classe nos camarades externes auxquels étaient
venues se joindre, à la rentrée de 1934, des jeunes filles de l'ancien Cours
secondaire. La mixité du Lycée Gérome était une véritable révolution dans le
contexte de l'époque. Chez les internes, la nouvelle fit l'effet d'une bombe,
si bien que M. Malrieu, jeune et brillant professeur de latin, crut bon de
consacrer à un pareil événement son discours de distribution des prix en
juillet 1935. Il soulignait avec une remarquable éloquence que cette année de
cohabitation entre filles et garçons avait été un succès, qu'il régnait entre
eux « une bonne et franche
camaraderie », une « saine
émulation ».
Une photo
de groupe datant de cette époque nous montre une trentaine d'élèves devant les
arcades de la cour des externes, dix filles devant, avec La Gouache, le
professeur de dessin, et tous les garçons derrière, soigneusement peignés et
vêtus pour la circonstance.

Il est à
noter qu'après la Première Guerre mondiale l'uniforme avait disparu, sans doute
en réaction contre la terrible époque bleu
horizon. Seules subsistaient encore quelques casquettes comme celles des
anciennes générations. J'en portais une au début de mes études secondaires,
l'arborant fièrement en signe d'appartenance au corps des bahutiens, de
même que je portais à la boutonnière l'insigne de l'Union Sportive du Lycée
Gérome.
Si dans les
années
L'origine
sociale des élèves jouait, je crois, un rôle mineur, hormis pour André Caquot,
dont le père était ingénieur des chemins de fer et dont l'oncle n'était autre
qu'Albert Caquot, membre de l'Académie des Sciences. Nous avions dans nos rangs
quelques enfants de fonctionnaires et de militaires, fils de préfets,
d'officiers ou de responsables de services administratifs envoyés pour quelque
temps dans un petit chef-lieu de département, mais le gros de la troupe se
composait essentiellement de Haut-Saônois bon teint, fils ou filles de
notaires, de médecins, d'enseignants, d'artisans, d'agriculteurs. Un ensemble
en somme assez homogène, sur lequel tranchaient parfois les noms
aristocratiques des officiers de cavalerie tels de Laclos ou de Rohan-Chabot.
S'il y
avait disparité, c'était plutôt entre externes et internes, ces derniers
souvent boursiers constituant une sorte de confraternité soudée par des années
de vie commune. Cette existence quelque peu monacale et militaire à la fois,
poursuivie pendant six ou sept ans, a été pour moi décisive à plusieurs égards.
J'y ai noué des liens d'amitié pour la vie, j'y ai appris le travail
intellectuel, j'y ai découvert les origines de la culture occidentale, ce que
l'on appelait les humanités et qui de nos jours n'est plus guère qu'un
souvenir.
Voilà ce
que nous ont enseigné nos vieux maîtres, dans les vieilles salles du lycée,
avec de vieux bouquins sans images en couleur et souvent griffonnés par des
générations de potaches. Nous n'avions ni radio, ni télévision, ni ordinateurs
ni portables, mais nous savions écrire le français, faire un thème latin ou
allemand, réciter du Racine, du Goethe ou du Virgile. Voilà ce que signifiait
l'inscription gravée au-dessus de la porte des externes : Gymnasium Deo,
patriae et bonis artibus.
Tout cela, me direz-vous, était plutôt austère pour de jeunes garçons. Il est certain que dans les lycées de la République, l'éducation n'était pas sans rappeler l'époque des Pères Jésuites et du Premier Empire. Cependant nous avions aussi, heureusement, des moments de détente, y compris pendant les heures d'étude, surtout la plus tardive, entre 19 et 20 heures. Nous avions alors la permission de lire des romans et d'écrire des lettres. Il arrivait alors qu'un quidam introduise un livre interdit, que tout le monde lisait en tapinois, ou bien qu'un plaisantin invente une farce pour amuser la galerie. Personnellement, je pense ne jamais m'être ennuyé au lycée.
L'année
scolaire se terminait toujours avec solennité par la distribution des prix, à
la veille du 14 juillet. Cette manifestation était présidée par une
personnalité politique ou par le président de l'Association amicale des anciens
élèves du Lycée Gérome. La fanfare du 11ème Régiment de Chasseurs à
cheval, stationné au Quartier Luxembourg, l'animait grâce à des airs martiaux.
Le discours
d'usage représentait le côté culturel de la séance. Il était prononcé par un
professeur nouveau dans l'établissement, donc généralement jeune. En 1934, ce
fut le tour d'un agrégé de philosophie, M. Lautman, frais émoulu de l'ENS, en
1935 celui de M. Malrieu, agrégé des lettres, qui devait terminer sa carrière
comme directeur de la Cité Universitaire de Paris, en 1936 celui de M.
Dufrenne, agrégé de philosophie, en 1939 de M. de Saint-Jacob, agrégé
d'histoire, mort prématurément et qui a donné son nom à une salle de la Faculté
des Lettres de Dijon. Inutile d'ajouter que ces distingués enseignants ne
faisaient pas de vieux os dans une petite ville de province où l'Administration
les avait envoyés en pénitence.
Le 14
juillet marquait le début des grandes vacances, qui duraient jusqu'au 1er
octobre. L'enseignement primaire n'était en vacances que le 1er
août, si bien que mes parents travaillaient deux semaines de plus que moi. Pour
les autres congés, à Noël et à Pâques, le primaire et le secondaire étaient à
peu près à égalité.
Les
lycéens, surtout les internes, étaient bien contents de retrouver leur liberté
après un trimestre de contraintes et de labeur. La plupart d'entre eux
passaient les mois d'été dans leur famille et dans la région. Les voyages
étaient en général limités et assez rares, la mode n'étant pas au tourisme de
masse.
Pour mon
compte personnel, je faisais traditionnellement des séjours prolongés dans mon
pays natal, à Fougerolles et dans les
alentours. J'y retrouvais mes grands-parents, mon oncle, mes tantes, mes
cousines et la nombreuse parenté de ma mère, disséminée à travers la campagne
fougerollaise. Je m'y sentais tellement chez moi, tellement choyé par ma
famille que je laissais mes parents partir sans moi pour de brefs voyages en
Alsace, dans le Jura ou les Alpes.
Je garde de
cette époque quelques photographies anciennes : je suis à califourchon sur le
cyclomoteur de ma tante Marie-Louise, avec mes cousines Jeannine et Edmée,
 nous sommes assis tous les trois sur le
marchepied de la Citroën C4 de mon père,
nous sommes assis tous les trois sur le
marchepied de la Citroën C4 de mon père,

nous sommes
campés sur le grand balcon de la tonnellerie, où j'ai passé tant de moments
heureux les soirs d'été. Ou bien encore nous voici, maman, ma cousine et moi à
Quincey, aux grottes de Champdamoy, à la Motte.
Il faut
signaler ici un événement important survenu en 1935, à savoir l'acquisition par
mes parents, en mai de cette année-là, d'une grande partie de la propriété
Richard. Le lot qui nous échut comprenait la cour située au fond de l'impasse,
la maison principale, le jardin et le verger.

Cet achat
permettait à mon père de remiser sa voiture dans la grange et de s'adonner au
jardinage et à l'arboriculture. Il dut accomplir un dur labeur pour remettre en
état une vaste propriété depuis longtemps mal entretenue. Mais ce travail lui
convenait, car il adorait les travaux de la terre et toute la famille profitait
du jardin, du verger et du calme de la nature. Une fois passée la porte de
notre verger, nous avions des kilomètres de bosquets, de prés, de vignes et de
friches à notre disposition. Quelle aubaine pour moi et mes petits camarades de
Quincey et d'ailleurs !
Par
ailleurs nous fîmes, ces années-là, plusieurs séjours au bord de la mer. Ma
mère, conseillée par les médecins depuis notre premier voyage en Bretagne en
1929, estimait que les bains de mer me seraient salutaires, ainsi qu'à
elle-même. De plus, mon père voyageait alors volontiers, y compris avec sa C4.
C'est ainsi
qu'en août 1933 nous prîmes le chemin des Côtes-du-Nord, voyage interminable
qui dura deux jours. J'avais onze ans et ma cousine Jeannine, qui nous
accompagnait, en avait sept. Les routes n'étaient pas encombrées, mais les
autos ne roulaient pas vite. Pour les enfants, un pareil voyage était
fastidieux. Nous comptions les moulins à vent et les troupeaux de moutons. Nous
finîmes par arriver du côté de Paimpol, à Ploubazlanec, plus précisément au
hameau de Pors Éven.
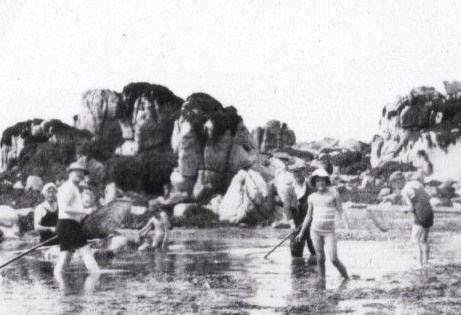
Quelle ne
fut pas notre stupéfaction lors de notre arrivée à l'hôtel d'y rencontrer …le
frère de mon père, la tante Renée et mon cousin Roger. Mais cette coïncidence
n'était pas tout à fait fortuite, car les uns et les autres avaient trouvé la
même adresse dans l'École libératrice, le journal des instituteurs.
Le
pittoresque des côtes rocheuses, les petits ports de pêche, la rude vie des
marins partis pêcher la morue en Islande nous impressionnèrent. Je suis
retourné là-bas presque trois-quarts de siècle plus tard. La nature est
toujours là, mais dans le port de Paimpol les bateaux de plaisance ont remplacé
les goélettes, et au marché les coiffes des Bretonnes ont disparu.
En 1934,
mes parents décidèrent de mettre le cap vers le sud. Nous partîmes, par la
route Napoléon, jusqu'à Gap, puis le lendemain vers Nice, où mon père devait
assister à une réunion concernant, me semble-t-il, la fondation de la MAAIF. Le
but de notre voyage était de prendre nos vacances à Sanary-sur-Mer. Les photos
prises par maman montrent mon père et notre logeur jouant aux boules avec moi
sous les palmiers du quai,
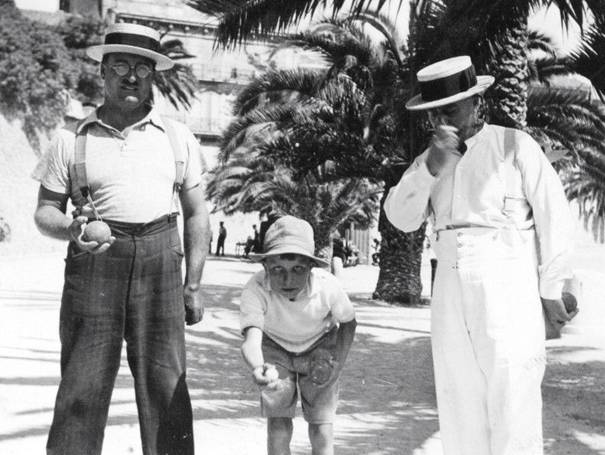 des cuirassés dans la rade de Toulon, un
transatlantique à La Ciotat, des oliviers dans l'arrière-pays varois, enfin
quelques monuments romains en Provence, sur le chemin du retour. Nous ne
savions pas que nous avions côtoyé à Sanary tout un groupe d'écrivains
allemands célèbres, réfugiés là-bas pour échapper aux nazis.
des cuirassés dans la rade de Toulon, un
transatlantique à La Ciotat, des oliviers dans l'arrière-pays varois, enfin
quelques monuments romains en Provence, sur le chemin du retour. Nous ne
savions pas que nous avions côtoyé à Sanary tout un groupe d'écrivains
allemands célèbres, réfugiés là-bas pour échapper aux nazis.
L'année
1936 nous ramena en Bretagne, cette fois à Pornichet près de La Baule. Les
plages étaient superbes, les rochers aussi. Nous entreprîmes plusieurs
excursions intéressantes, en particulier à Guérande, où maman fit des photos
réussies des vieux remparts. Mais mon souvenir le plus marquant concerne les
Jeux Olympiques de Berlin, qui se déroulèrent en août et que je suivis avec
passion dans la presse sportive.
1936 était
également l'année des premiers congés payés, une vraie révolution dans le monde
du travail. À Pornichet comme ailleurs, les premiers ouvriers parisiens
apparurent sur les plages.
J'omettais
de raconter qu'au cours des étés 1934, 1935 et 1936, j'étais un fervent
admirateur des coureurs du Tour de France, que je suivais jour après jour dans
le journal L'Auto. Je lisais ce quotidien, imprimé sur papier jaune, de
la première ligne à la dernière, en dépit du style pompier de ses articles. Je
savais tout sur Antonin Magne, vainqueur du Tour en 1934, de même que sur ses
coéquipiers Archambaud, Lapébie, Speicher, Louviot et Vietto, que nous allions
voir pédaler au Ballon d'Alsace. Le dérailleur n'étant pas autorisé, ils
s'arrêtaient au sommet et retournaient leur roue de derrière pour changer de
braquet. Tous avaient un boyau, voire deux, en bandoulière pour réparer en cas
de crevaison. Les routes n'étant pas toutes bonnes, les pannes étaient
fréquentes et les accidents aussi. L'équipe de France, plusieurs fois
victorieuse auparavant, s'effondra en 1935 au profit des Belges, d'abord Romain
Maës, puis Sylvère Maës en 1936. À l'époque, on ne parlait pas de dopage, et le
Tour n'était pas mondialisé comme aujourd'hui.
Je terminai
mes vacances de 1936 par un séjour à Villersexel, chez Pierre Vuillemin. Comme
il sortait parfois le dimanche chez nous, sa mère m'invitait chaque année à
passer quelques jours chez eux. Nous nous connaissions un peu avant 1933, et
ceci pour deux raisons. La première tenait à un lien de parenté entre M.
Vuillemin, vétérinaire à Villersexel, et son cousin Auguste Vuillemin, de
Fougerolles. La deuxième concernait la famille Chatelot, famille de médecins
dont descendait Pierre du côté maternel. Son grand-père avait soigné ma mère
avant son mariage, et la famille Nurdin lorsqu'elle habitait à
Villers-la-Ville. Et plus tard, c'était l'oncle de Pierre qui venait me soigner
à Arpenans.
À
Villersexel, je me sentais donc un peu chez moi. Je m'y rendais par le chemin
de fer vicinal qui, venant de Vesoul, faisait halte à la petite gare de
Quincey, près de la scierie Chevillard. Le petit train s'arrêtait dans presque
tous les villages, chargeant des marchandises et des gens du coin, parmi
lesquels des paysannes allant vendre leurs volailles et leurs œufs au marché.
Le spectacle était coloré à souhait. C'était l'époque où l'on prenait son
temps, du moins à la campagne.
La vie à
Villersexel était d'un calme absolu, mais nous ne connaissions pas l'ennui. Au
centre du bourg, il y avait quelques boutiques dont la librairie de M.
Vuillemin, l'oncle de Pierre. Ce libraire avait été, comme le vétérinaire,
élève au lycée de Vesoul. Il nous laissait fouiller dans les bouquins et
feuilleter ceux qui nous intéressaient. C'est ainsi que nous avons découvert, à
la veille de la guerre, les prophéties de Nostradamus, dont nous tentions
d'appliquer les prédictions sibyllines à la situation de notre époque.
Nous
faisions du vélo et du tennis. La vallée de l'Ognon, à la limite du Doubs et de
la Haute-Saône, ne manque pas de charme. Et Villersexel avait déjà l'avantage
de posséder un court de tennis sur lequel nous pouvions jouer à peu près chaque
jour. Là encore, je possède des photos où je figure avec Pierre, sa sœur
Janine, sa tante Marie-Rose, l'épouse du Dr Chatelot.
Ce n'était
pas tout. Pierre Vuillemin n'était pas doué qu'en sciences et en lettres, mais
aussi en dessin et en musique. Ce sont du reste ses dons artistiques qui le
poussèrent plus tard à faire carrière dans le cinéma.
Pour passer
agréablement le temps, nous avions formé un petit orchestre dans lequel mon ami
jouait du piano et moi du banjo, instrument plus maniable que le violon. Nous
interprétions les airs à la mode, ceux de Vincent Scotto et de Ray Ventura.
Tino Rossi était alors au sommet de sa carrière, ainsi que Maurice Chevalier.
Parmi les nombreuses chansons de ces années 1930, deux étaient particulièrement
comiques et eurent un grand succès : Au Lycée Papillon et Tout va
très bien, Madame la marquise.
Si cette
antienne est restée célèbre, c'est sans doute parce qu'elle était parfaitement
adaptée à la situation de l'époque. Nous vivions sans le savoir les dernières
années de la Troisième République. Le peuple français venait de consentir des
sacrifices inouïs durant la guerre. Vers 1930, il était confronté à la crise
économique touchant l'Europe après les États-Unis. En fait, la situation
générale était inquiétante, mais on préférait l'ignorer.
Jusqu'au
moment où, le 6 février 1934, éclatent à Paris les sanglantes émeutes
déclenchées par l'affaire Stavisky et suivies des grèves générales du 12
février, la République parlementaire chancelle, les cabinets
radicaux-socialistes tombent les uns après les autres, pris en tenailles entre
les ligues d'extrême-droite et les mouvements d'extrême-gauche. Désormais le
fossé se creuse entre les idéologies opposées. La France va mal au moment où,
en mai 1936, le Front Populaire remporte les élections et vote, en juin, les
Accords Matignon, les lois sociales sur les congés payés, les conventions collectives,
la semaine de 40 heures.
Ces
réformes sociales étaient intempestives dans une Europe où sévissaient des
régimes comme le fascisme italien et le nazisme. En Allemagne, Hitler avait,
dès 1933, instauré la dictature du parti unique, ouvert des camps de
concentration, annihilé les opposants. En 1934, il avait écrasé les SA et
s'était proclamé président du Reich à la mort de Hindenburg. En 1935, il avait
rattaché la Sarre à l'Allemagne, réintroduit le service militaire et fait
promulguer les lois antisémites. Enfin, en 1936, il réoccupa la Rhénanie en
mars et fit des Jeux Olympiques de Berlin une démonstration de force.
Inutile de
dire que tous ces événements, français et allemands, avaient des répercussions
directes dans notre famille, au sein de laquelle s'exprimaient des opinions
divergentes.
Mon père
avait adhéré dans les années 1920 à la SFIO, comme ses amis instituteurs
Jacquot, Gaspard et Jeannin, comme quelques villageois d'Arpenans et, si ma
mémoire est bonne, l'oncle de Pierre Vuillemin, le libraire de Villersexel. Les
réunions se tenaient à Villersexel ou à Lure, le chef-lieu d'arrondissement.
Cotin, un
ouvrier, fut élu député et maire de Lure en 1928, et en 1932 ce fut le tour de
Frossard, soutenu par Vincent Auriol en personne.
Oscar Louis
Frossard, originaire du Territoire de Belfort, instituteur et journaliste,
resta député de Lure de 1932 à 1940, et maire de Ronchamp jusqu'à sa mort en
1946. Il fut ministre en 1936, 1938 et 1940. Remarquable orateur, il joua un
rôle déterminant au Congrès de Tours (1920), après avoir auparavant représenté
le socialisme français à Moscou. En rupture avec le Parti Communiste dans les
années 1920, il fit donc carrière à la SFIO mais avec un opportunisme qui le
mena à voter les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Son fils André poursuivit ce
glissement de la gauche vers la droite par sa conversion au catholicisme,
racontée dans un ouvrage qui fit grand bruit : Dieu existe, je l'ai rencontré
(1968).
Avant de
dire pourquoi Frossard intéressait la famille Nurdin, je voudrais évoquer ici
un autre homme politique de gauche dont il était souvent question chez nous. Il
s'agit de Georges Cogniot[2]
(1901-1978), que ma mère a connu enfant lorsqu'elle était à l'École Normale. Né
dans un village perdu de la Haute-Saône, Cogniot fréquenta le Lycée Gérome de
1908 à 1919, c'est-à-dire l'année où mon père, rentrant de captivité, y était
surveillant.
Supérieurement
doué, le jeune boursier entra à l'École Normale Supérieure et passa
l'agrégation de lettres. Ayant adhéré très jeune au Parti Communiste, il quitta
l'enseignement en 1928 pour se consacrer à ses nombreuses activités politiques
et syndicales, sur le plan national et international.
Dans les
années 1930, il se consacra au mouvement antifasciste, fut élu député de Paris
en 1936 et représentant du PCF à l'Internationale à Moscou, où il vécut à
plusieurs reprises avant et après la guerre, notamment comme rédacteur en chef
de L'Humanité au moment des procès contre les trotskistes (1938) et du
20ème Congrès du PCUS (1956).
Maîtrisant
admirablement, non seulement les langues anciennes, mais aussi plusieurs
langues étrangères, Cogniot traduisit pour la délégation française le fameux
rapport de Khrouchtchev sur les crimes de Staline. Personnalité complexe,
militant engagé et esprit surdoué, il laisse une œuvre politique, sociale et
philosophique considérable.
Il
incarnait, quelles que soient ses opinions politiques, pour des enseignants
comme mes parents, l'idéal de la méritocratie républicaine, l'élite
intellectuelle de la France formée dans la plus prestigieuse des écoles, l'École
Normale Supérieure de la rue d'Ulm.
Tel était
aussi le cas d'Edouard Herriot et de Léon Blum. Mon grand-père tenait Herriot
pour son "chef de file", mon
oncle Jean Nurdin et son épouse Renée avaient chez eux le portrait de Blum. Et
c'est pour soutenir l'action de Blum et de Frossard que mon oncle et ma tante
quittèrent, au début des années 1930, la région de Gray pour enseigner dans le
bassin minier de Ronchamp, ville dont Frossard était maire. Ils purent désormais
militer à volonté pour la SFIO, participer aux campagnes électorales et faire
de la propagande auprès des populations laborieuses de l'arrondissement de
Lure.
En fait,
mon oncle avait beaucoup moins la fibre militante que sa femme. Élevé à la campagne
comme mon père, il préférait la vie dans la nature aux joutes politiques.
Ma tante,
fille d'un sculpteur sur bois de Saint-Loup, était une femme intelligente et
moderne qui cherchait sincèrement à améliorer le sort du peuple. Dans la
famille et ailleurs, elle était naturellement très critiquée, une femme étant
censée s'occuper de son ménage. Lorsqu'au lendemain de la guerre de 1939-1945
elle se présenta comme suppléante aux élections législatives, ni mon grand-père
ni mon père ne votèrent pour elle. Le seul suffrage qu'elle eut dans la
famille, à part celui de son mari, fut le bulletin de mon grand-oncle Pol,
frère de mon grand-père.
J'ai déjà
évoqué précédemment les discussions politiques qui terminaient les repas de
famille à La Vaivre, lorsque nous étions réunis chez ma grand-mère. SFIO et
radical-socialisme, Blum et Herriot, ma tante et mon grand-père :
l'affrontement portait sur la société socialiste, la république bourgeoise, le
bolchevisme, le fascisme, le pacifisme, le capitalisme.
Vers
En ces
temps de trouble et d'incertitude, les extrêmes envoûtaient les esprits
déboussolés. En Allemagne, des communistes votaient pour Hitler. En France, les
ligues d'extrême-droite recrutaient. Les Croix de feu du colonel de La
Rocque, mouvement d'anciens combattants fondé en 1927, comptaient 260 000
adhérents en 1935 et avaient une audience politique considérable. Ils avaient
participé, de manière assez pacifique, aux manifestations nationalistes et
antiparlementaires des 5 et 6 février 1934. Après la dissolution des ligues de
droite en 1936, de La Rocque créa le PSF (Parti Social Français).
Nous
étions, mes parents et moi, assez bien renseignés sur ces mouvements, pour la
simple raison que l'oncle Henri était partisan des Croix de feu et
vouait aux gémonies le Front Populaire, Blum et la plèbe. Ses prises de
position véhémentes n'ont heureusement jamais affecté nos relations familiales.
Avant de
mettre un point final à ce chapitre, je ne saurais oublier quelques événements
qui ont marqué les esprits. Plusieurs furent dramatiques, comme la mort de
Briand en mars et celle de Doumer en mai 1932. Avec la disparition d'Aristide
Briand, c'était une période de paix et de rapprochement avec l'Allemagne qui se
terminait. Avec l'assassinat du président de la République Paul Doumer s'en
allait un homme austère et vertueux, lui aussi symbole de la méritocratie
républicaine, puisque issu d'une humble famille du Cantal il était parvenu au
sommet de la hiérarchie. Il avait perdu quatre fils sur cinq en 1914-1918 et
avait donc bien mérité de la patrie. C'est pourquoi les Leyval avaient le plus
grand attachement envers lui, d'autant plus qu'il était l'ami de la famille
Remy du Val-d'Ajol, elle-même très liée à ma tante Gabrielle, comme je l'ai
rappelé dans un autre chapitre.
La fin de
l'année 1933 fut marquée par une nouvelle catastrophe, le terrible accident de
chemin de fer de Lagny, qui provoqua la mort de plus de 200 personnes, dont
celle du député-maire de Vesoul Paul Morel. Paul Morel était le grand-père de
Simone Morel, notre camarade de classe
au lycée. Je me souviens encore de l'immense émotion qui s'empara de Vesoul et
de sa région en ces derniers jours de décembre
L'été 1934
devait m'apporter une expérience importante, à savoir une première excursion en
territoire allemand. L'oncle Henri, ingénieur électricien à Nancy, avait des
contacts fréquents avec la Sarre. Un beau jour, il nous emmena, mes parents et
moi, à Sarrebruck. J'en ai retenu qu'au restaurant on mangeait sans pain et que
le gibier en sauce était servi avec de la confiture de groseilles. J'en conclus
que les Allemands avaient des goûts bizarres, jusqu'au jour où j'appris que cet
étrange mélange avait une utilité bien précise. Mais ce qui me frappa surtout,
ce furent les drapeaux à croix gammée et les saluts hitlériens le long de la
route.
Lorsque le
13 janvier 1935 le plébiscite de la Sarre donna plus de 90% des voix pour le
rattachement au Reich, je n'en fus guère surpris.
Hitler fit
encore mieux le 29 mars 1936 après la réoccupation de la Rhénanie, puisqu'il
obtint 99% de oui. Des années plus tard, un ami allemand m'expliqua le
déroulement du scrutin : des SA en uniforme distribuaient devant les bureaux de
vote des bulletins Ja, et ceux qui par malheur mettaient dans l'urne un
bulletin Nein étaient vite repérés…